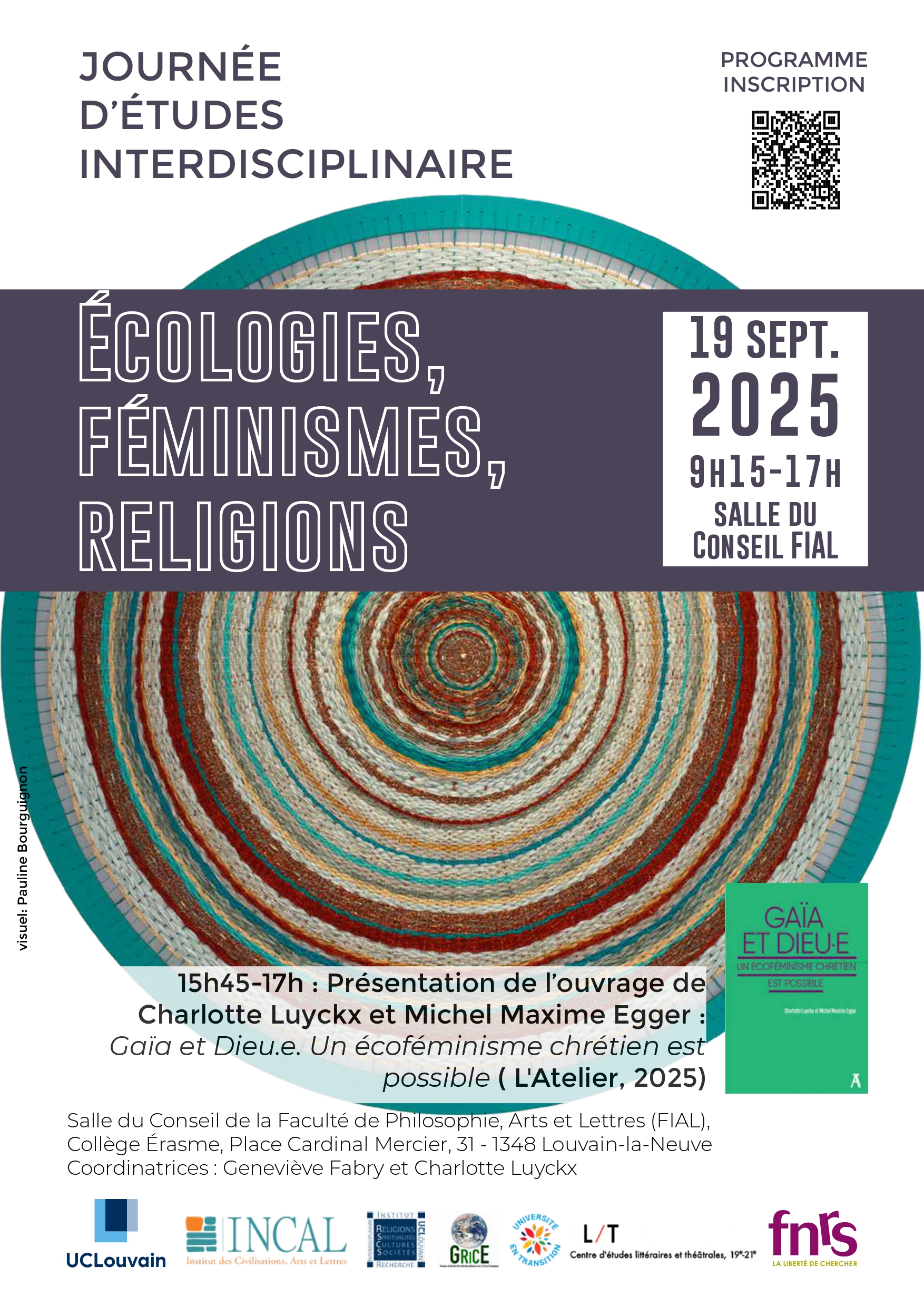Gaïa et Dieu.e
Ouvrages Gaïa et Dieu.eDépasser l’oppression conjointe des femmes et de la nature en inscrivant cette lutte dans la foi chrétienne n’est pas impossible. Gaïa et Dieu.e explore cette rencontre entre l’écoféminisme et le christianisme à travers les réflexions visionnaires de grandes théologiennes d’horizons divers, comme Rosemary Radford Ruether, Sally McFague et Ivone Gebara. Les textes de cette anthologie, inédite en langue française, ouvrent de nouvelles voies critiques et créatives pour penser le divin et la nature à partir de l’expérience des femmes. Une manière de nourrir des engagements pour la libération et la justice, étendues à l’ensemble du vivant. Un ouvrage essentiel pour réinventer la tradition chrétienne à l’ère de l’urgence écologique et des combats féministes.
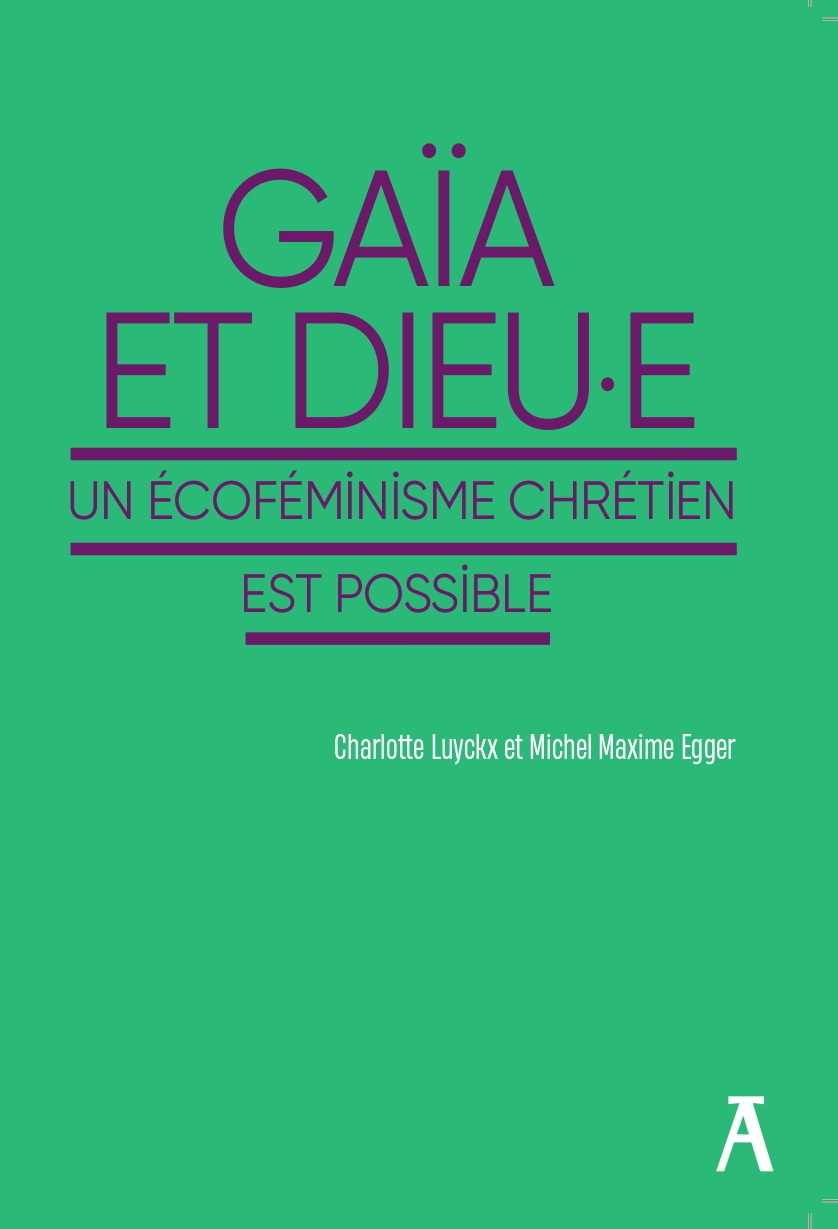
Un ouvrage écrit à quatre mains par Michel Maxime Egger et Charlotte Luyckx, docteure en philosophie, chargée de cours invitée à l’UCLouvain et à l’UNamur en Belgique, et chercheuse indépendante. Elle a notamment écrit Écophilosophie (Academia, 2020) et co-dirigé Écobiographies en Anthropocène (Presses Universitaires de Louvain, 2024).
Recensions
A l’heure des débats autant passionnés que justifiés sur la place des femmes dans la société, leur implication dans la mouvance écologique et plus largement au sein des traditions religieuses, l’ouvrage co-écrit par Charlotte Luyckx et Michel Maxime Egger arrive à point. Son originalité est multiple. Tout d’abord, il publie (enfin) en langue française une anthologie de textes de figures écoféministes et théologiennes majeures, dont Elisabeth A. Johnson, Rosemary Radford Ruether, Ivone Gebara… Il pallie ainsi une lacune intellectuelle en rendant accessible à la sphère francophone des thèses théologiques issues de l’écoféminisme jusque-là largement ignorées.
La substantielle et très instructive introduction rédigée par les deux auteurs ainsi que les introductions des chapitres permettent d’entrer en profondeur dans la réflexion théo-écoféministe. S’immerger dans ce vaste et complexe univers est tout à la fois inspirant et déconcertant, voir déstabilisant à celui, celle qui répugne à pratiquer ce qu’Edmond Husserl appelle «l’épochè»: la suspension du jugement afin d’entendre et de mieux comprendre les thèses d’autrui. Bref, «écouter» sans à priori.
L’intuition profonde, «fondatrice et fédératrice», au sein de l’écoféminisme est qu’il existe «des interrelations profondes… entre l’oppression de la nature et celle des femmes» (p. 16). Toutes deux procèdent d’un même système de domination. Le «cadre patriarcal et dualiste» en serait la cause première, généré à travers «plusieurs processus qui ont masculinisé et extériorisé Dieu.e, domestiqué, féminisé et désenchanté la nature, naturalisé et infériorisé les femmes» (p. 19). La vision patriarcale finit par inférioriser la nature par rapport à la culture et à aliéner les femmes en les réduisant à certaines tâches considérées comme «naturelles» (p. 21).
Ce sont là parmi les principales notes de la pensée éco-féministe, de sa critique d’un «cadre conceptuel» et culturel «oppressif». De nombreux questionnements «critiques» ne manqueront pas d’interroger, de surprendre, voire de crisper certains lecteurs et lectrices: «libérer la Trinité de ses œillères androcentriques», «Dieu.e comme mère», «le monde, corps de Dieu.e», les «fins dernières» délimitées à une «conversion vers la Terre et vers les autres…», non l’espérance «de nouveaux cieux et une terre nouvelle», etc.
L’approche écoféministe chrétienne n’en demeure pas moins du plus haut intérêt pour stimuler l’inépuisable compréhension du réel à laquelle tout être humain est appelé pour accomplir ce qu’il est. Comme toute approche novatrice, l’écoféminisme chrétien suscite un exigent travail de recontextualisation et de réinterprétation créative de la foi biblique, de «repenser de manière radicale tous nos repères cosmiques, culturels et vitaux» (p. 39). Ce qui ne va pas sans revisiter les fondements des concepts théologiques et autres interprétations traditionnelles de la Bible et des dogmes.
Comment être fidèle au signifié de la Révélation sans le dénaturer? Comment accepter la déstabilisation de son référentiel de valeurs, qu’il soit religieux ou politique? Comment aller au-delà d’un «Dieu monarque, transcendant, Père» sans sombrer dans la vision d’un Dieu unilatéralement «sujet, immanent, Mère»? La manière féministe de comprendre l’écologie, le cosmos, la création appelle «une nouvelle manière de penser Dieu» (Ivone Gebara), de reconsidérer la dogmatique (Trinité, Création et Salut, Eglise et Sacrements, Eschatologie…). Et par suite, de repenser l’anthropologie et l’engagement éthico-politique.
Le défi auquel nous convoque l’écoféminisme chrétien ne peut être relevé sans omettre que Dieu est «au-delà de tout». Nos manières de l’appréhender seront toujours inaptes à le concevoir exhaustivement. Sa révélation christique ne décerne pas un point final aux formulations dogmatiques. Elle manifeste un point d’orgue «événementiel» par lequel est transmise l’énergie d’une incessante quête: aller «de commencement en commencement par des commencements qui n’ont jamais de fin» (Grégoire de Nysse).
En ce sens, l’écoféminisme chrétien – qui n’a rien d’un oxymore – peut être un précieux soutien dans l’intelligence du mystère divin et notre avancée en Celui qui demeure «la Voie, la Vérité et la Vie» (Jean 14, 6).
Chrétiens Unis pour la Terre, Lettre Maison commune, juin 2025.
L’écoféminisme analyse les liens entre l’oppression de la nature et celle des femmes, propose des perspectives et des réponses aux enjeux écologiques et féministes actuels. En général, il s’oppose aux monothéismes, plus particulièrement au christianisme, à cause de sa culture jugée patriarcale et dualiste.
Pourtant, un dialogue entre l’écoféminisme et le christianisme est possible. C’est ce que défendront Charlotte Luyckx, docteure en philosophie, chargée de cours invitée à l’UCLouvain et à l’Université de Namur en Belgique et chercheuse indépendante, et Michel Maxime Egger, théologien, qui présenteront leur livre Gaïa et Dieu.e. Un écoféminisme chrétien est possible le mercredi 18 juin, à 17h, à Payot Lausanne.
L’ouvrage propose une traduction inédite en français de nombreux textes clés de ce courant, issue de diverses autrices anglophones. Rosemary Radford Ruether, Sallie McFague – que les lecteurs de Réformés ont pu découvrir dans le hors-série Dieu, la nature et nous –, MaryJudith Ress, Heather Eaton et bien d’autres.
Réformés, No 89, juin 2025
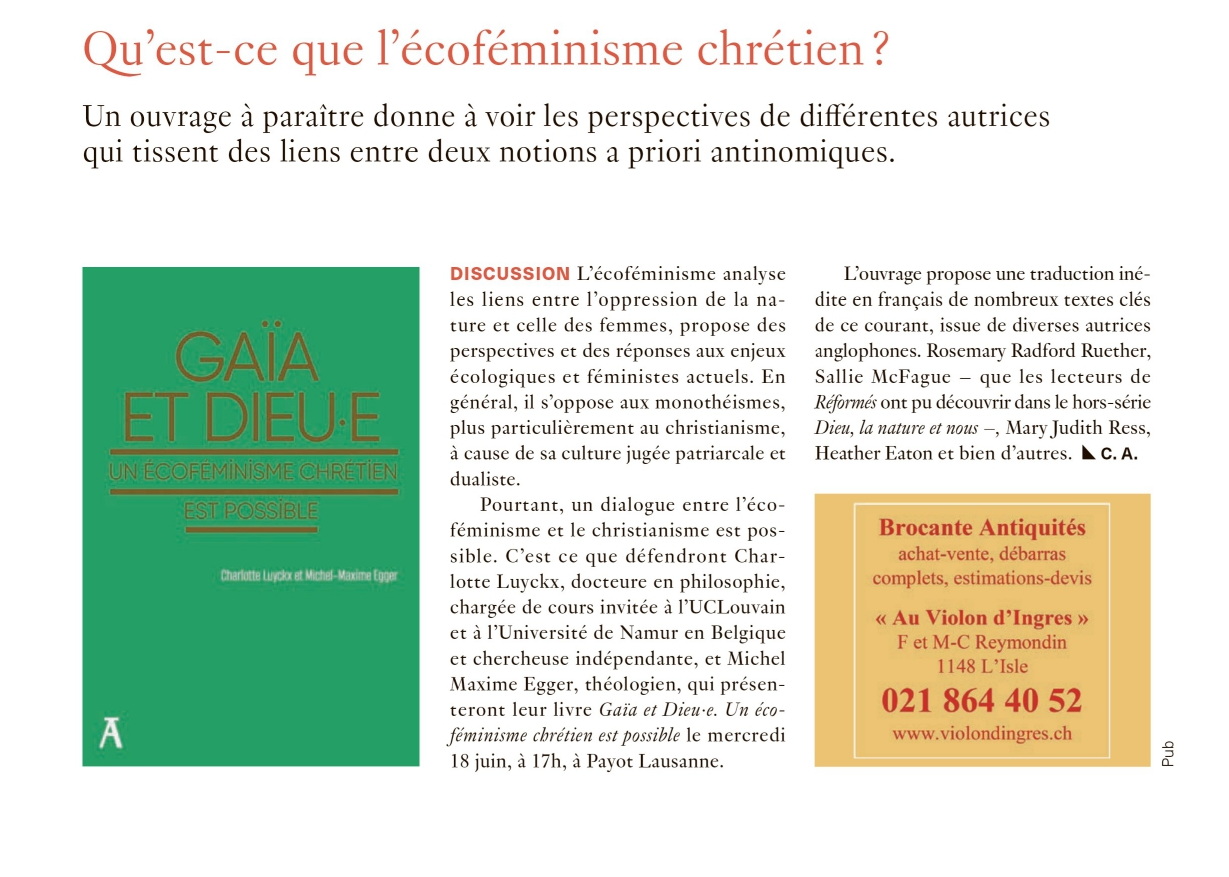
«Dépasser l’oppression conjointe des femmes et de la nature en inscrivant cette lutte dans la foi chrétienne n’est pas impossible.» Pour le démontrer, la philosophe Charlotte Luyckx et l’écothéologien Michel Maxime Egger ont réuni dans leur livre les écrits de dix-sept femmes, pour la plupart théologiennes, certaines se revendiquant féministes, voire écoféministes. En entrant dans Gaïa et Dieu.e, il est utile de ne pas oublier qu’il y a plusieurs féminismes, comme il y plusieurs manières d’être chrétien ou écologiste, ceci afin d’éviter les grandes généralités. Cela dit, il est vrai qu’à priori les religions – et le christianisme ne fait pas exception – sont plutôt patriarcales, en tout cas dualistes. Ce qui a pour conséquence de séparer les hommes des femmes, puis les femmes et les hommes de la nature, sans oublier la matière et l’esprit.
Tout l’intérêt de cette anthologie est de nous donner à lire des pensées sortant des schémas habituels. Le chapitre deux est intitulé Dieu.e au-delà des genres? «Dieu est à la fois masculin et féminin, dit l’Etats-Unienne Rosemary Radford Ruether (1936-2022), mais en même temps il n’est ni masculin ni féminin.»
Une des questions passionnantes du livre concerne la différence entre le panthéisme – Dieu est tout ce qui existe, tout ce qui existe est Dieu – et le panenthéisme – tout est en Dieu. Autrement dit entre les concepts d’immanence et de transcendance.
Pourquoi s’intéresser à ça? Pourquoi vouloir concilier christianisme et écoféminisme? Une des raisons peut être trouvée chez la Québecoise Pierrette Daviau: «La crise écologique n’est pas d’abord d’ordre matériel, mais d’ordre moral et spirituel […] Nous ne sortons jamais de la nature puisque la nature est en nous.»
Bon pour la tête, 4 juillet 2025
Au-delà d’avoir réussi à trouver le titre le plus provoc’ possible, la docteure en philosophie Charlotte Luyckx et l’écothéologien Michel Maxime Egger ont exploré comment il est possible de lier la foi chrétienne et la lutte contre l’oppression des femmes et de la nature.
Dans cet ouvrage érudit, les auteurs montrent comment repenser certains traditions chrétiennes permet de réconcilier le christianisme avec le combat écoféministe, qui vise à libérer la nature et les femmes d’une logique de domination patriarcale. L’ouvrage réunit le travail d’une quinzaine d’expertes sur le sujet et chaque chapitre est introduit par une note d’intention. Une compilation bienvenue qui mériterait une vulgarisation pour le grand public.
Christianisme Aujourd’hui, juillet-août 2025
Pour la première fois, un ouvrage réunit des textes en français d’autrices écoféministes chrétiennes. Méconnu, ce courant de pensée offre une ressource pour repenser nos liens au vivant, expliquent-elles. Repères.
L’écoféminisme essaie de rendre visibles les liens entre plusieurs formes de domination : celles des femmes et de la nature. Pour bon nombre d’autrices de ce courant, la religion chrétienne fait partie du problème: elle constitue l’un des cadres culturels contribuant à construire ces oppressions. Le christianisme y est donc vu comme un repoussoir, non comme une ressource. Pourtant, depuis au moins trois décennies, des écoféministes chrétiennes au Québec, en Inde, en Afrique du Sud, au Brésil et aux Etats-Unis travaillent à se réapproprier les traditions chrétiennes pour y trouver d’autres représentations et interactions possibles avec les femmes et la nature. Leurs œuvres sont rarement traduites et éditées en français.
Ce manque vient d’être réparé: une anthologie de leurs textes est parue en mai (voir note) sous la codirection de Charlotte Luyckx, docteure en philosophie, chargée de cours invitée à l’Université catholique de Louvain (Belgique) et chercheuse indépendante, et de Michel Maxime Egger, sociologue et écothéologien d’enracinement orthodoxe.
Qui sont les écoféministes chrétiennes?
Parmi elles, des théologiennes majeures: Rosemary Radford Ruether (1936-2022), Sallie McFague (1933-2019), qui a notamment forgé l’idée métaphorique du monde comme «corps de Dieu», des spécialistes des liens entre éthique chrétienne et science comme Celia Deane-Drummond (1956). Marquée par une grande liberté, la pensée des écoféministes chrétiennes est souvent «ancrée dans l’expérience, intégrant aussi les dimensions d’intériorité, du corps, de la vie quotidienne, des expériences banales du quotidien», explique Charlotte Luyckx. Et comprend fréquemment une dimension politique.
Leurs principes et grandes idées
Ces penseuses ne nient pas les dimensions patriarcales du christianisme, mais cherchent à compléter, dépasser, voire transformer cette vision en se basant sur le corpus biblique et la tradition chrétienne. Elles intègrent aussi de nouveaux récits cosmologiques, par exemple 1’«hypothèse Gaïa», qui voit la planète Terre et le vivant reliés, comme un écosystème dynamique, en interaction permanente.
Repenser toute la théologie chrétienne implique de questionner bon nombre de concepts fondamentaux, mais l’une des discussions centrales «implique de changer notre manière de dire et comprendre le concept de Dieu», remarque Michel Maxime Egger. Plutôt qu’une image «monarchique» d’un père qui sous-tend «des caractéristiques de domination», des «schémas oppressifs envers les pauvres, les femmes, la terre», il s’agit ainsi de retrouver des caractéristiques féminines de Dieu dans la Bible. Mais aussi de trouver des traces de sa présence dans le monde et peut-être de «prendre congé de la transcendance», au minimum de repenser les liens entre transcendance et immanence.
Quelles limites?
Leur retour au corps peut faire craindre un retour à un certain essentialisme. Et puisque l’objectif est de réformer la théologie, comment le faire à partir de concepts extérieurs à ce champ puisque les critères mêmes de validation de la théologie lui sont inhérentes? Enfin, leur vision du monde peut parfois apparaître comme une clé de lecture unique.
Quelles conséquences?
La force de ces autrices est de permettre de «redéfinir et réactualiser la tradition chrétienne, d’en faire quelque chose de vivant», estime Charlotte Luyckx. Elles offrent au christianisme la possibilité de tisser des liens avec d’autres champs, de mettre à jour les sources de spiritualité chrétienne ou d’en trouver de nouvelles. Cette pensée se distingue par une «capacité permanente d’autocritique et une non-absolutisation», observe Michel Maxime Egger. Autrement dit, il s’agit plutôt de rechercher, d’inventer, de questionner, non d’établir de nouveaux dogmes ou visions totalisantes. Reste à ce courant intellectuel désormais accessible de trouver des échos, réalisations et relais sur le terrain.
Réformés, No 89, septembre 2025

On se souvient du rendez-vous en partie manqué, il y a toute juste un an, entre la communauté universitaire de Louvain-la-Neuve et le pape François. La première avait interpelé le second: «Laudato si’ porte les germes d’une réflexion prometteuse pour l’inclusion de toutes et de tous. Mais comme souvent dans l’histoire de l’Église, les femmes ont été invisibilisées.» La réponse de François était tombée à plat: «La femme est accueil fécond, soin, dévouement vital.»
Si le défunt pape avait eu entre les mains l’ouvrage que voici, il est permis de penser que sa réponse aurait eu d’autres harmoniques. Ce livre nous plonge dans un courant de la pensée chrétienne extrêmement fécond mais peu connu dans le monde francophone: l’écoféminisme chrétien. Une anthologie de textes de théologiennes qui «revisitent la tradition chrétienne à partir des critiques féministes et écologiques qui lui sont adressées» et «proposent de nouvelles interprétations et ouvrent des chemins de traverse inspirants et mobilisateurs», à l’heure d’affronter les défis écologiques et sociaux.
Les deux auteur.e.s de ce recueil, Charlotte Luyckx et Michel Maxime Egger, elle comme écophilosophe, lui comme écothéologien, nous gratifient d’une riche introduction qui s’ouvre avec un parcours des différentes ramifications de la «nébuleuse écoféministe» et permet d’identifier la spécificité de la branche chrétienne qui marche sur une «ligne de crête» entre déni des problèmes de la domination masculine et réduction de la tradition chrétienne à ses seuls défauts.
Cette introduction propose aussi une synthèse éclairante de différentes thématiques comme la mise en question d’une représentation masculine et exagérément transcendante de Dieu ou une nouvelle compréhension moins anthropocentrique de l’être humain et de la création. Les chapitres sont distribués selon ces différentes thématiques, le dernier étant moins une conclusion qu’une fenêtre sur différents chantiers que ce mouvement a ouverts: le rapport à la sexualité, la liturgie, la spiritualité militante, la justice sociale, etc.
Même si la familiarité avec le vocabulaire théologique en facilitera la lecture, ce recueil reste accessible. Un livre qui donne faim! Faim de poursuivre avec ces théologiennes le chemin d’une réappropriation et d’une refondation de la tradition chrétienne.
En question, n°154, septembre 2025.
C’est à une philosophe enseignant à l’UCLouvain et à l’UNamur et à un écothéologien orthodoxe suisse (dont L’Appel a parlé à plusieurs reprises) que l’on doit cette anthologie de réinvention de la tradition chrétienne à l’ère des urgences écologiques et des combats féministes. L’ouvrage reprend d’indispensables réflexions de théologiennes qui montrent que la relation entre le Dieu biblique et
Gaïa, la Terre, est amicale, sinon de fusion. De quoi aider à penser le divin et participer à la préservation de la nature et de l’ensemble du vivant, aux engagements pour la justice et à l’émancipation des femmes face à la domination patriarcale.L’Appel, n°480, septembre 2025.
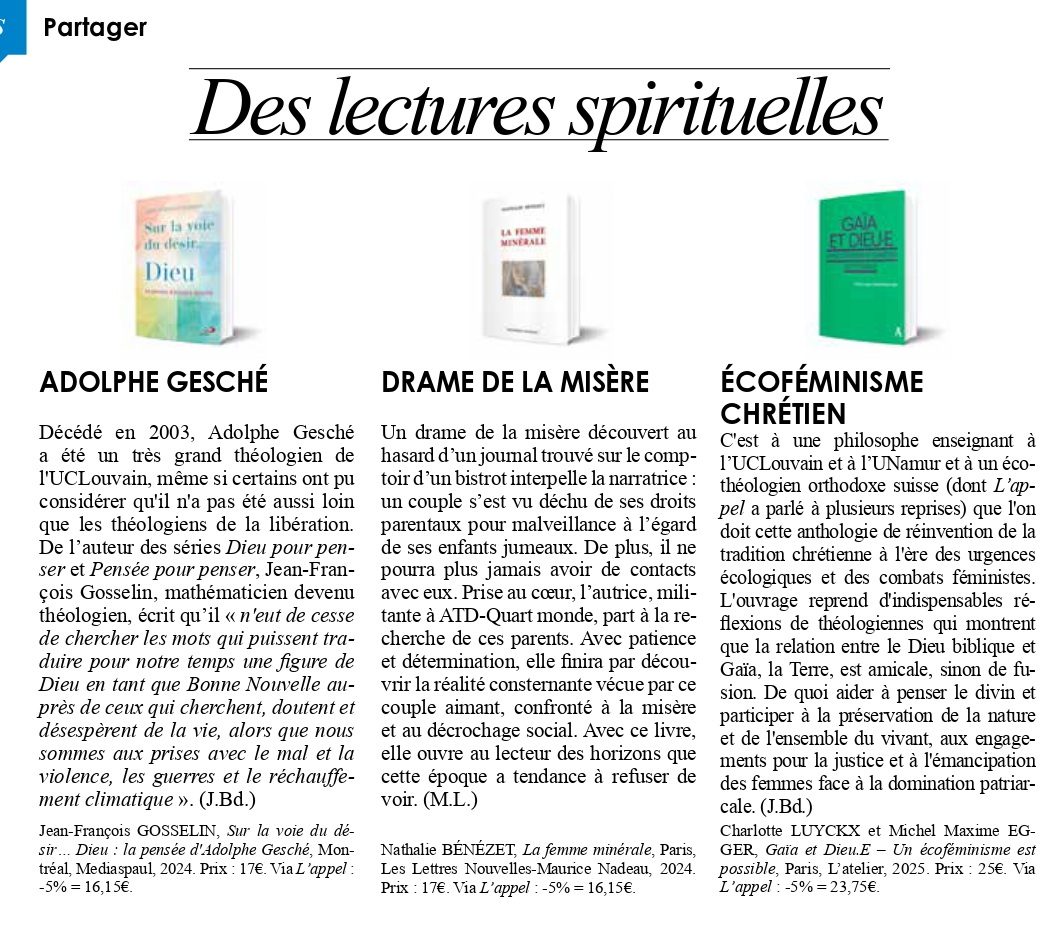
Emissions et podcasts
Ecoféminisme chrétien, une voie possible?
Est-il possible de réinventer la tradition chrétienne à l’ère de l’urgence écologique et des combats féministes? Dans le cadre de l'émission , au micro de Carole Pirker, Charlotte Luyckx montre comment des théologiennes écoféministes explorent cette question. L’enjeu, qui est au cœur de l’ouvrage Gaïa et Dieu.e (Editions de l’Atelier), consiste à réformer la tradition en déconstruisant notamment le modèle d’un Dieu patriarcal et anti-écologique. Babel (RTS), 15 juin 2025. Retranscription condensée de l'interview.
L’écoféminisme chrétien «bouscule» nos conforts de pensée
Dans cet entretien avec Angélique Tasiaux et Manu Van Lier, Charlotte Luyckx revient sur son parcours de chercheuse engagée, ses réflexions autour de l’écologie intégrale et spirituelle, ainsi que sur son dernier ouvrage, Gaïa et Dieu.e. Un écoféminisme chrétien est possible, coécrit avec Michel Maxime Egger. L'occasion d'explorer les liens entre écologie, spiritualité et féminisme, et de proposer une relecture audacieuse de la tradition chrétienne à l’aune des enjeux contemporains. Un échange profond sur l’écospiritualité, la réappropriation du corps, et les chemins vers une société du soin. Pleins Feux (CathoBel / RCF Belgique), 8 septembre 2025. Retranscription condensée de l'interview.
Evénements et conférences
Pour d'autres événements sur et autour de l'ouvrage, voir la rubrique «Evénements».
22 mai 2025, Paris: table ronde au Forum 104
Animée par l'écojournaliste Christine Kristof, une rencontre sur le thème «Ecoféminisme: une chance ou un risque pour le christianisme?», avec le théologien catholique Fabien Revol, l’essayiste Audrey Fella, Charlotte Luyckx et moi-même.
Replay de la soirée également accessible en visioconférence.
.jpeg)

Christine Kristof
Avec la lecture de l’ouvrage de Charlotte Luyckx, et de Michel Maxime Egger. Gaïa et Dieu-e , un écoféminisme chrétien est possible, je réalise combien le sujet de l’écoféminisme est crucial à la fois parce qu’il implique un questionnement radical de nos systèmes de croyances, de nos représentations et nos schémas mentaux, jusque dans l’intime, parce qu’il croise de nombreux sujets essentiels et parce qu’il représente une contribution incontournable à la mutation de notre société et une réponse large aux enjeux actuels de la crise écologique, sociale et spirituelle.[…]
En lisant l’ouvrage, j’ai pris également une conscience progressive de l’« omerta » sur ce sujet; une omerta à laquelle je réalise me soumettre involontairement.[…]
Cela m’attriste et me met en colère, car je me sens, malgré moi, à la fois complice et victime de cet état de fait. D’une façon générale, on n’ose pas vraiment parler de ces sujets: «cela dérange», «cela fâche», «cela ne se fait pas»… et en définitive, cela n’arrange personne d’aborder sérieusement la question de l’écoféminisme, qui plus est de l’écoféminisme chrétien.
Il est incroyable de voir que les écrits de ces femmes, thé@logiennes, philosophes, chercheuses… qui ont pensé et vécu le sujet depuis une cinquantaine d’années, et qui sont présentées dans le livre Gaïa et Dieu-e, le sont pour la première fois en français. Tous les textes sont des traductions originales réalisées par Michel Maxime et Charlotte. Ce livre et cette soirée sont une «première»! J’ai le sentiment qu’une chape de plomb se lève enfin. Il était temps. Un grand merci à Charlotte et à Michel Maxime pour ce courage, pour la prise de risque, pour ce travail considérable et essentiel![…]
En conclusion, la lecture de cet ouvrage est pour moi, et je l’espère pour notre époque, une grande bouffée d’air pur, qui ouvre des perspectives d’espérance dans un monde sclérosé et augure d’une nouvelle relation au Vivant. Il agit comme un facteur de libération,d’épanouissement et d’harmonie…
Les témoignages de ces femmes me donne envie de «ne plus me taire» et de retrouver ma liberté de penser, d’agir, d’aimer, de servir au nom de ma foi et de dire: «cela suffit!», avec fermeté et douceur.Pour lire l’intégralité de son préambule.
Fabien Revol
J’attendais depuis longtemps un tel livre. Il aborde et fait connaître une thématique importante. Il met à disposition des textes peu connus et difficiles d’accès. Cela, à travers un travail éditorial conséquent. Grâce à une substantielle introduction générale au début du livre puis à des brèves introductions pour chaque partie, il prend le lecteur par la main et nous guide dans cette découverte.
Audrey Fella
Un ouvrage riche et clair, accessible avec de belles portes d’entrée pour toutes et tous. Un plaidoyer pour une connaissance vivante et un dialogue d’amour au service d’un monde meilleur.
21 mai 2025, Paris: rencontre à la librairie Le Delta

18 juin 2025, Lausanne: rencontre à la librairie Payot, modérée par Patrick Morier-Genoud

.jpeg)

18 septembre 2025, Bruxelles: table ronde au Forum Saint-Michel

19 septembre 2025, Louvain-la-Neuve: journée d'études à l'université