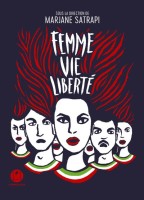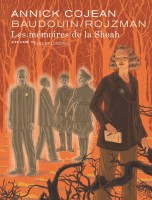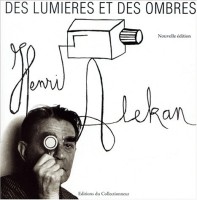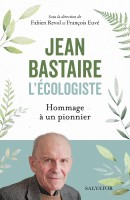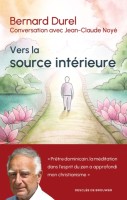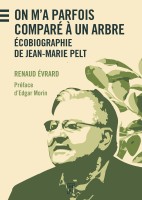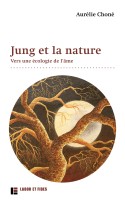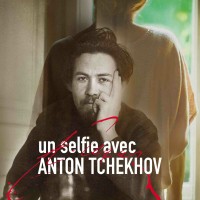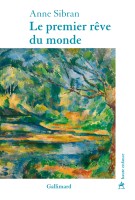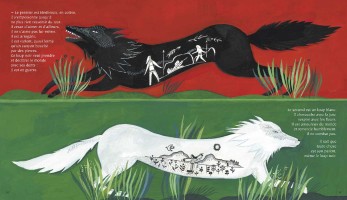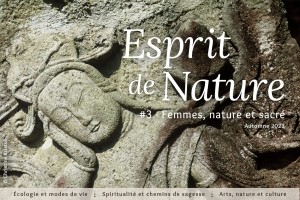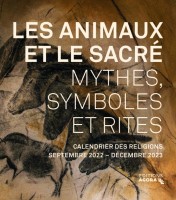Aurélie Choné: Jung et la nature
Coups de coeurLa nature a joué un rôle très important dans la vie et la pensée de Carl Gustav Jung. Elle apparaît, de manière transversale et arborescente, à de nombreux endroits de son œuvre. Nourrie par la fréquentation d’autres cultures, l’approche du psychanalyste se révèle d’une grande actualité et fécondité pour répondre en profondeur aux défis écologiques. Par son exploration des interrelations intimes entre le vivant et la psyché humaine, elle constitue une source d’inspiration pour l’écopsychologie. Il manquait un ouvrage en français pour appréhender la richesse et la pertinence de l’apport du psychiatre suisse en ce temps de bouleversements écosystémiques. Le livre d’Aurélie Choné, Jung et la nature. Vers une écologie de l’âme (Labor et Fides, 2025) comble cette lacune de belle manière.
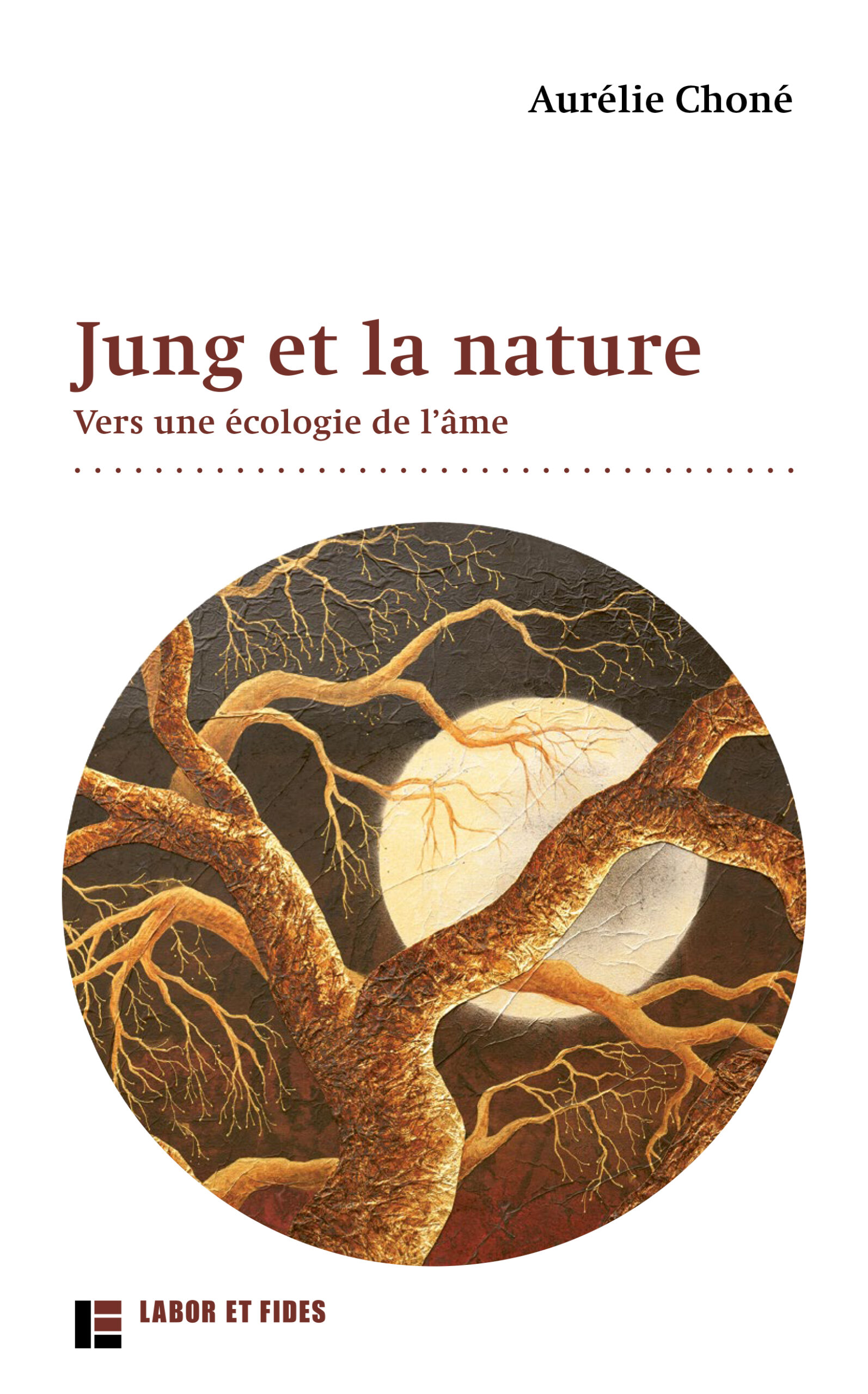
Professeure d’études germaniques à l’Université de Strasbourg, Aurélie Choné a consacré depuis une dizaine d’années son travail de recherche aux liens entre nature et culture, humains et autres qu’humains, écologie et spiritualité. Carl Gustav Jung (1875-1961) occupe une place de choix à ce carrefour, souvent ignorée ou négligée ainsi que l’ont montré les nombreuses manifestations autour du cent cinquantième anniversaire de sa naissance. Forte de sa fréquentation assidue de l’œuvre du psychiatre suisse, Aurélie Choné nous propose – de manière à la fois profonde, complète et accessible – une synthèse de la vision jungienne de la nature.
Dans l’introduction, au sein d’une évocation biographique, elle souligne une double ambivalence chez Jung. D’une part, celle de sa vision de la nature, à la fois source de vie et de mort, créatrice et destructrice, fascinante et démonique. D’autre part, celle de sa personnalité: sociale et rationnelle d’un côté, fusionnelle avec la nature et mystique de l’autre. Ainsi, la relation de Jung à la nature s’inscrit de manière souterraine mais non moins claire dans la tradition romantique allemande, loin d’une vision simplifiée et béate d’une nature idyllique, bonne et belle. La réflexion de l’autrice se déploie en huit temps et autant de chapitres.
Ouverture à d’autres cultures
1. Jung était sensible à l’état de la planète, même si la situation n’était pas aussi grave et urgente qu’aujourd’hui. Il a connu la peur d’une attaque nucléaire, dans le contexte de la guerre froide. En 1955, alors âgé de 80 ans, il exprime son angoisse de l’avenir dans une lettre à un ami: «Nous n’en sommes encore qu’au début de cette évolution apocalyptique! Me voilà déjà deux fois arrière-grand-père, et je vois grandir cette génération lointaine dont, longtemps après nous, la vie va s’engager, irrémédiablement, dans ces ténèbres.»
Dans son diagnostic, Jung montre les liens entre le mal-être humain et la crise écologique. Les deux s’originent dans une méconnaissance de notre nature intérieure, indissociable du reste du vivant perçu comme extérieure à nous. Cette déconnexion entre notre âme et la nature, liée à une rationalité triomphante, conduit à la désacralisation et à la domination destructrice de la Terre.
2. Pour sortir du grand partage – analysé notamment par Philippe Descola – entre nature et culture, Jung s’est tourné vers d’autres «ontologies de la nature» que celle, «naturaliste», de l’Occident qui réduit la nature à sa matérialité en lui déniant toute forme d’esprit et d’intériorité. Il a exploré nombre de traditions extra-européennes comme autant de sources d’inspiration. D’une part, les peuples premiers d’Afrique (Maroc, Kenya), du Nouveau-Mexique et d’Amérique latine, qui l’initient au chamanisme, au totémisme et à l’animisme. D’autre part, la pensée chinoise et les spiritualités de l’Inde, qui le fascinent par leur connaissance profonde des lois de la nature, notamment en matière de conservation et de transformation de l’énergie. Comme le livre l’affirme plus loin, la nécessaire refondation ontologique appelle également à tenir ensemble le rationnel (logos) et le non-rationnel (mythos), à passer d’une pensée intellectuelle et discursive à une pensée vivante et imaginative.
Energétique psychique
3. Dans sa recherche sur les interrelations complexes entre la nature et la psyché, Jung a développé une conception stratigraphique de cette dernière. La couche la plus profonde correspond à l’être «primitif» à l’intérieur de soi, qui nous relie au «sein étroit de la Terre» dont nous sommes issus. Cette dimension «archaïque» est une composante essentielle de l’inconscient collectif, au même titre que les archétypes culturels.
Jung reprend l’idée de l’âme du monde ou «unus mundus» comme expression d’un fond commun entre le biologique et le psychique. Toute son approche – «par-delà nature et culture» – vise à dépasser les dualismes. Le Soi, inconnaissable et mystérieux, est à la fois cosmique et terrestre, divin et animal, féminin et masculin. Les polarités existent, mais il s’agit de les considérer en termes non d’opposition, mais de tension créative.
La clé de cette dynamique est «l’énergétique psychique» que Jung développe à partir des pensées indiennes et chinoises. Celles-ci lui ont permis de comprendre les lois d’équilibre de la nature – la conservation, le progrès et la relation entre les deux – qu’il transpose au niveau psychique. L’âme, dans cette perspective, apparaît comme un écosystème psychique autorégulé dont le langage est le symbole, puissant et vivifiant transformateur d’énergie.
4. A partir de ces fondements, Jung a élaboré une véritable éthique du vivant à l’écoute de sa sagesse. Le végétal nous enseigne la nécessité de l’enracinement dans la terre où notre âme puise «la nourriture obscure des profondeurs», mais aussi le principe de la croissance et la verticalité. La reconnexion au règne animal nous permet de saisir – dans notre chair – que nous sommes des animaux appelés à vivre en accord avec nos instincts et à ressentir de l’empathie envers les autres animaux. Cette réharmonisation de l’agir humain avec les «lois de la nature», la terre et tous les êtres qui l’habitent, participe de l’individuation. Jung la définit comme un «processus naturel» de réalisation du Soi pour devenir une «unité autonome et indivisible», une «totalité» ouverte et en devenir.
Christianisme sur la sellette
5. Dans la mesure où les croyances – notamment religieuses – conditionnent l’écologie, Aurélie Choné souligne que, pour Jung, ainsi qu’il l’a mis à jour dans le Livre rouge, la «voie de l’à-venir» nécessite une revisitation critique de la tradition chrétienne. C’est ce que dira aussi Lynn White Jr. dans un texte célèbre sur les racines de la crise écologique dans la revue Science en 1967: «Davantage de science et davantage de technique ne viendront pas à bout de l’actuelle crise écologique, tant que nous n’avons pas trouvé une nouvelle religion ou repenser l’ancienne.»
Jung n’est pas tendre avec le christianisme dans lequel il a grandi. Pour lui, il a joué un rôle majeur dans le dualisme entre la matière et l’esprit, le dénigrement de l’animal et l’errance des morts. En cause notamment le rejet du mal, identifié au péché, extrêmement dommageable pour la psyché des chrétiens, car elle génère une «schize» qui les coupe d’une partie essentielle – instinctuelle, archaïque, animale – de leur être. Afin de redonner un souffle nouveau à la tradition chrétienne, «il s’agit donc de réécrire le mythe judéo-chrétien de la création pour retrouver le sens du mystère, du secret et de l’initiation».
Le sacrifice du Christ constitue l’acte rédempteur par lequel la création entière est sauvée. Jung insiste sur le lien entre l’esprit et la matière, le divin et la nature, sur le chemin initiatique: «Ce miracle spirituel de la rédemption, ou du parachèvement qui va se produire en l’homme, signifie aussi le sacre de la nature toute entière. Alors, tout ce qui était enchaîné sera libéré en même temps que les enfants de Dieu.»
Il convient – en retrouvant le sens du mystère et de l’initiation – de se relier à un fonds païen et de s’ouvrir aux religions de la terre. Il s’agit de faire une expérience intérieure, vivante et «non clivée» du divin. Cela suppose de réintégrer l’être archaïque, de se confronter aux forces obscures de la psyché en sortant des catégories morales du bien et du mal, ainsi que de prendre soin des ancêtres en intégrant les revendications des morts, la connexion aux éléments et aux autres vivants. Une forme de «polythéisme de l’âme».
Questions critiques
6. Si Jung n’a pas proposé des écothérapies en tant que telles, il pratiquait pour lui-même diverses formes de reconnexion à la nature. Dans ses séjours réguliers dans sa «tour» à Bollingen, au bord du lac de Zurich, loin de l’agitation de la vie moderne et citadine, il prenait plaisir à une vie très simple en communion avec les éléments. Il parle d’«un sentiment de parenté avec les choses». Thérapeutique, cette expérience sensible du vivant était indissociable d’une approche psychique à travers l’imagination active et le travail sur les rêves. Deux portes pour, concrètement, «entrer dans l’inconscient» et «toucher la nature de l’intérieur». Comme il le dit, «un rêve surgit comme un animal. Je pourrais être assis au milieu de la forêt, et voici qu’apparaît un daim».
7. Explorateur ouvert à l’intuition et irréductible à tout esprit de système, Jung a fait l’objet de contestations. Aurélie Choné passe au crible de la critique sa pensée de la nature. Peut-on accuser Jung d’avoir une pensée occidentalocentrée et anthropocentrée? Était-il conservateur, antimoderne et réactionnaire? Était-il un grand bourgeois fortuné et privilégié peu engagé au niveau social et politique? La réalisation de soi et du Soi reste-t-elle réservée à une élite? Au niveau religieux, n’a-t-il pas sombré dans un mysticisme de la nature plutôt obscurantiste et ésotérique? Peut-on lui reprocher de n’avoir pas su développer des techniques thérapeutiques impliquant le corps et le milieu naturel ? N’a-t-il pas proposé une interprétation des rêves finalement très anthropocentrée? Aurélie Choné présente les objections et les réponses en en montrant les enjeux actuels. Elle le fait avec doigté, en suivant une ligne de crête où elle veille à ne tomber ni du côté de l’apologétique ou de l’«admiration aveugle», ni du côté de «la critique stérile et infondée».
8. L’œuvre de Jung a constitué et est toujours une source d’inspiration pour l’écopsychologie. Transdisciplinaire et pluriel dans ses incarnations, ce nouveau champ de recherche – qui s’est développé dès les années 1990 avant tout dans les pays anglo-saxons – étudie les interactions profondes entre la psyché et la nature, les souffrances humaines et celles de la Terre. Aurélie Choné montre les influences – théoriques et pratiques – de la pensée jungienne sur ces nouvelles approches, par exemple à travers la notion d’inconscient écologique.
Noces avec l’âme
Pour la chercheuse, en conclusion, l’apport le plus important de Jung est d’avoir montré que la question écologique est un problème de culture, qui est lui-même un problème d’âme. C’est parce que nous ne nous sommes pas suffisamment préparés à rencontrer les éléments et le vivant – y compris à un niveau symbolique – que nous avons pillé la Terre. C’est parce que nous sommes enfermés dans un rapport au monde fondé sur la domination, l’appropriation, l’avidité et la performance que nous n’avons pas laissé la nature se dévoiler à nous. Dans l’expérience de l’âme, nous pouvons vivre notre sensibilité intérieure et entendre résonner l’âme du monde. Ce dialogue entre notre propre individualité et l’individualité de l’univers mène au bout du compte à des noces avec l’âme. Il nécessite un processus initiatique qui demande une préparation à laquelle les êtres humains sont aujourd’hui appelés, d’une manière plus urgente que jamais.