Ecoféminisme chrétien, un oxymore?
ÉcospiritualitéL’écoféminisme est un courant de pensée en expansion, dont une part recèle une forte composante spirituelle, en particulier de tendance néopaïenne. S’il est souvent critique du christianisme, il existe aussi un écoféminisme chrétien. Sa réflexion porte, entre autres, sur la représentation du divin et la critique d’un langage religieux trop masculin. Les propositions, qui peuvent apparaître comme provocatrices, méritent d’être entendues et débattues. L’écoféminisme chrétien peut renouveler la réflexion théologique. Présentation synthétique de ses contenus et de ses enjeux.
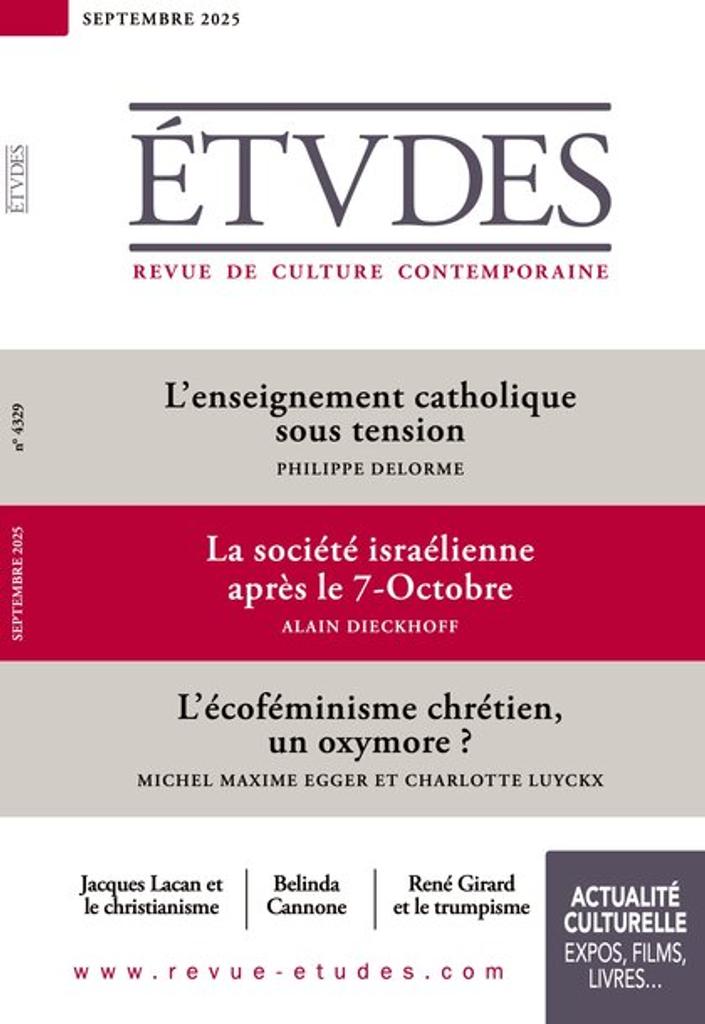
Depuis une dizaine d’années, l’écoféminisme a le vent en poupe. Comme son nom l’indique[1], il exprime le projet d’unir écologie et féminisme. Il recouvre à la fois un champ de recherche et un mouvement militant, avec notamment deux tendances souvent en tension: sociale-matérialiste et culturelle-spirituelle. En constante évolution, fruit de contextes divers au Nord et au Sud, il intègre un large spectre de positions, approches et activités. Au point d’apparaître comme un «jardin composite et touffu»[2].
Sortir du patriarcat et des dualismes
Au cœur de cette pluralité, les groupes et personnes qui se réclament de l’écoféminisme partagent cependant une intuition fédératrice, étayée par de nombreuses études: il existe des liens étroits – historiques et actuels, symboliques et structurels – entre l’oppression des femmes et la destruction de la nature. Les deux proviennent d’un même système de domination. Karen J. Warren parle à cet égard de «cadre conceptuel patriarcal», c’est-à-dire un ensemble de représentations, valeurs et attitudes, qui « explique, justifie et maintient la subordination des femmes par les hommes»[3] ; il génère un «système social dysfonctionnel» qui se manifeste dans des institutions, des rôles, des comportements et un langage.
C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre le lien entre féminisme et écologie. En explorant ses racines philosophiques et théologiques, certaines écoféministes montrent qu’il repose sur un processus complexe qui – de la philosophie antique à la modernité occidentale, en passant par les monothéismes – a masculinisé et extériorisé Dieu⸳e[4], féminisé et désacralisé la nature, naturalisé et infériorisé les femmes. Il en a découlé une série de dualismes qui ont alimenté les logiques de domination. D’un côté, la transcendance de Dieu, la culture, l’esprit, l’âme, la raison et les hommes. De l’autre, l’immanence divine, la nature, la matière, le corps, les émotions et les femmes.
«D’une manière générale, l’écoféminisme exprime le désir de guérir les blessures causées par ces divisions»[5], écrit Heather Eaton. Il vise à en sortir en traçant des chemins de libération, d’empowerment et de justice. Pour la Terre et pour les femmes, mais aussi pour toutes les parties de l’humanité victimes d’oppressions et de discriminations liées au genre, la classe sociale, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle ou encore l’histoire coloniale. L’écoféminisme s’est inscrit dès ses débuts dans une dynamique d’intersectionnalité.
Dans les années 1970 et 1980 où elles ont émergé, les luttes écoféministes ont porté notamment sur la course à l’armement nucléaire entre l’Ouest et l’Est et les inégalités Nord-Sud. Après un creux de la vague à partir du milieu des années 1995, le mouvement a connu une forme de renaissance depuis 2015 à la faveur de la vague #MeToo, de l’urgence climatique et du mouvement de la transition. L’un des signes est l’efflorescence de l’écoféminisme spirituel avec – dans ses incarnations néopaïennes – la résurgence du culte de la Déesse, la réhabilitation des sorcières et la vogue du féminin sacré.
Le christianisme sur la sellette
Dans ce renouveau, l’écoféminisme chrétien est peu présent. Et pour cause: l’écoféminisme et le christianisme sont souvent perçus de manière antagoniste. Pour les courants dominants de l’écoféminisme, parler d’un écoféminisme chrétien est un oxymore, tant le christianisme serait – culturellement et structurellement – imprégné du cadre conceptuel patriarcal. Du côté des Eglises et de l’establishment théologique, on navigue plutôt entre la méfiance et le rejet. C’est que l’écoféminisme appelle à revisiter de manière critique et novatrice la tradition chrétienne, en réhabilitant le sacré immanent, le féminin, le corps, la sexualité, les émotions et d’autres modes plus sensibles de connaissance. Au risque, pour certains, de glisser dans des formes d’hérésie et de néopaganisme.
Fait significatif, la dimension féminine et les femmes sont «les grandes absentes de l’encyclique Laudato si’»[6]. C’est le constat de la communauté de l’UCLouvain dans une lettre adressée au pape François à l’occasion de sa visite, en septembre 2024, pour les 600 ans de l’institution. Interpellé sur cette lacune et, plus globalement, sur la place des femmes dans l’Église, le pape a répondu en rappelant que «l’Église est une femme […], l’épouse», que «la femme est accueil fécond, soin, dévouement vital» et qu’«il est mauvais que la femme veuille faire l’homme». Ces propos ont suscité une réaction immédiate de l’université qui a exprimé publiquement son «incompréhension», sa «désapprobation» et son «désaccord» face à une telle «position déterministe et réductrice»[7].
L’écoféminisme et le christianisme sont-ils donc incompatibles, comme l’affirment certaines autrices «postchrétiennes» qui, à l’instar de Mary Daly et Carol Christ – endossant souvent la thèse d’un matriarcat originel – se sont tournées vers les spiritualités de la Déesse ou d’autres traditions de sagesse? Nombre de théologiennes ne le pensent pas. Pour elles, un écoféminisme chrétien est non seulement possible, mais nécessaire, si le christianisme entend répondre de manière significative aux enjeux actuels.
«Reclaim» chrétien
De fait, dès les années 1970, sur tous les continents mais en particulier en Amérique du Nord et du Sud, de grandes figures comme Rosemary Radford Ruether, Ivone Gebara ou encore Sallie McFague ont joué un rôle pionnier dans le développement d’un écoféminisme chrétien[8]. Intégrant les apports de la théologie féministe et de la théologie verte, elles ont opéré une forme de «reclaim»[9] écoféministe de la tradition chrétienne. Cet anglicisme, difficile à traduire, renvoie à une double tâche.
D’une part, un travail de réappropriation. Il s’agit – en les réinterprétant – d’aller chercher dans le corpus biblique et théologique des éléments susceptibles de nourrir de nouvelles perspectives plus inclusives, écologiques et favorables aux femmes. C’est notamment ce que fait Ruether avec le prophétisme biblique dont elle souligne les dimensions de justice et d’émancipation, l’alliance de Dieu·e avec toute la création par laquelle les êtres humains, les animaux et les végétaux forment une seule communauté de vie, la tradition sacramentelle qui conjugue immanence et transcendance divines, les apports novateurs de femmes mystiques médiévales comme Hildegarde de Bingen ou les béguines. D’autre part, une œuvre de réinvention et refondation. Le défi d’une théologie écoféministe digne de ce nom implique des démarches de déconstruction et reconstruction à tous les niveaux de l’exégèse biblique, de la réflexion et de la pratiques théologiques.
Cette revisitation, plus ou moins radicale, se déploie à partir de deux sources. La première est l’expérience des femmes, dans leurs liens existentiels et corporels à la nature, mais aussi dans ce que Dorothee Sölle appelle la «blessure» née de la «mutilation» de leur être et des violences dont elles ont été et sont l’objet. La seconde est la nouvelle vision scientifique du système Terre en tant que communauté d’écosystèmes et d’organismes en évolution constante, où tous les êtres vivants – humains et autres qu’humains – ont une valeur et sont dans une interdépendance réciproque. Anne Primavesi, par exemple, reconsidère toute la théologie de la création à partir de l’hypothèse Gaïa. L’un des buts est de renouer avec la conscience que nous sommes des êtres cosmiques et terrestres.
Si les théologiennes partagent avec l’écoféminisme spirituel la reconnaissance d’une parenté de l’être humain avec le reste du vivant, elles s’en distinguent aussi sur deux points. D’abord, créés à l’image de Dieu·e (Gn 1,27), nous avons un rôle spécifique et ne sommes pas réductibles à notre animalité : «Capables de conscience réflexive», nous sommes «l’esprit de l’univers, le lieu où l’univers devient conscient de lui-même»[10]. Ensuite, ainsi que le montrent tant le récit biblique que la science, la nature et l’humanité sont si enchevêtrées que «la nature elle-même est devenue un phénomène historique […] et qu’une bonne partie n’existe plus “naturellement”»[11]. On est donc loin du cosmocentrisme et de l’exaltation de la nature sauvage (wilderness) prônés par certains courants écologiques qui, en inversant les pôles, perpétuent le dualisme culture/nature.
Les deux axes du «reclaim» – réappropriation et refondation – supposent plusieurs exigences. Primo, une autocritique lucide. Il est capital que les Églises et leurs fidèles reconnaissent les travers patriarcaux et anti-écologiques de leur tradition. Secundo, de la créativité et de l’audace pour ouvrir de nouveaux chemins, inventer un imaginaire porteur et s’affranchir d’un langage religieux par trop masculin. Tertio, le sens de la nuance. Comme le souligne Eaton, «affirmer que le christianisme est la source de la domination des femmes ou du monde naturel, ou des deux à la fois, est trop simpliste»[12]. En effet, le christianisme est pluriel et la Bible un ensemble de textes où apparaissent plusieurs postures – oppressives et libératrices – à l’égard de la nature et des femmes. Quarto, l’adoption d’approches holistiques, transdisciplinaires, interreligieuses et inclusives. La théologie doit devenir plus «humble, existentielle, provisoire et ouverte au dialogue»[13].
Vision panenthéiste
Le «reclaim» écoféministe de la tradition chrétienne a ouvert un gigantesque chantier. Théologique, spirituel, éthique et politique. L’adoption d’une perspective post-patriarcale et d’un nouveau cadre cosmologique n’épargne aucune composante de la foi. Il s’agit de dépasser les dualismes et prendre congé tant de l’anthropocentrisme que l’androcentrisme. Pour cela, afin aussi d’en retrouver le sens profond et actuel, il convient de déverrouiller les «codes fermés» de notions clés comme la Trinité, le Christ, la création, le péché, le mal, la rédemption, le salut ou encore l’eschatologie. Il n’est pas possible d’aborder ici tous ces éléments. Nous nous limiterons à un champ de réflexion particulièrement crucial et emblématique dans la manière de croiser théologie verte et théologie féministe: la représentation de Dieu·e et de son lien avec la création.
Pour l’écoféminisme chrétien, les nouveaux défis planétaires appellent à changer la manière de vivre, comprendre et dire le mystère du divin. «Dieu emprisonné dans un langage donné, défini par certaines affirmations, connu sous des noms établis par des formes socioculturelles déterminées de pouvoir, n’est pas Dieu, mais il devient une idéologie religieuse»[14], écrit Dorothee Sölle.
Le modèle de Dieu comme Père n’est pas seulement patriarcal, mais aussi anti-écologique. En cause, les deux traits auxquels il est souvent associé: la royauté et la transcendance. D’un côté, un Dieu tout-puissant qui gouverne d’en haut la création et que l’être humain – à son image – va imiter, légitimé par le commandement biblique de soumettre la terre et tous les animaux qui la peuplent (Gn 1,26-28). De l’autre, un Dieu extérieur à la création qui, par là-même, se retrouve désenchantée, réduite à un objet et un gisement de matières premières. Selon Ruether, une telle vision n’est autre que «la projection sur Dieu des schémas sociaux d’oppression des femmes, des pauvres et de la Terre»[15]. Elle revient à «exclure les femmes, tous les animaux non humains et la terre de la sphère du sacré»[16]. Il convient donc de s’en délivrer.
Une première voie de sortie est le panenthéisme. Il consiste à «reconnaître la présence de Dieu dans le monde et celle du monde en Dieu»[17]. Contrairement aux courants néopaïens de l’écoféminisme, qui promeuvent un sacré immanent et féminin, mais aussi aux théalogiennes postchrétiennes pour qui la transcendance Dieu·e serait par essence patriarcale et aliénante, des écoféministes chrétiennes cherchent à réconcilier transcendance et immanence. C’est notamment le cas de Ruether, qui affirme: «Dieu est immanent dans sa transcendance et transcendant dans son immanence.»[18] Une clé, pour entrer dans ce paradoxe, est de cesser d’associer la transcendance à la masculinité, à l’esprit, à la distance et au ciel, et l’immanence à la féminité, à la matière, à la présence et à la terre.
Ruether souligne l’enjeu politique de cet équilibre. Là où l’immanence seule, en identifiant Dieu·e à ce qui est, peut conduire à justifier le réel existant – avec ses structures d’oppression, d’injustice et de mensonge – comme l’expression de sa volonté, la transcendance, par laquelle Dieu est radicalement libre envers nos systèmes de pouvoir, nous oriente vers ce qui devrait être. C’est par sa transcendance, «incluse dans le tissu de la vie» (Sölle) et donc en nous et entre nous, que Dieu·e peut nous communiquer sa puissance pour accomplir les libérations nécessaires au changement de paradigme requis pas l’état du monde.
Le maintien de la transcendance de Dieu·e permet également de ne pas idéaliser ou diviniser la nature. Certaines théologiennes refusent de la regarder «à travers une lentille paradisiaque, ignorant son visage violent et tragique»[19]. Point de nostalgie d’un Eden perdu à retrouver ou de vision romantique de la création donc, mais une conscience d’un mal cosmique – à distinguer du mal moral et du mal structurel – tissé de morts et de renaissances, de créations et de destructions. La nature est cruciforme. Elle est le lieu du salut, mais pas sa source.
Sagesse et Christ cosmique
Toujours dans l’axe de la réappropriation, d’autres pistes théologiques émergent pour penser Dieu·e de manière écoféministe en relation avec la création. Une première est la revalorisation de l’Esprit saint, en se souvenant que la ruah qui flotte sur les eaux au début de la Genèse est féminine en hébreu. Pour Johnson, le Saint-Esprit est le «flux incessant et dynamique de puissance divine qui soutient l’univers et fait naître la vie». Il est «l’énergie revitalisante qui renouvelle la face de la Terre»[20], en permettant au vivant de se déployer dans son extraordinaire richesse et diversité.
Une deuxième piste est la redécouverte de la Sagesse ou Sophia. Pour Celia Deane-Drummond, cette figure biblique offre un «visage féminin de Dieu se manifestant dans la communauté complexe de toutes les créatures et dans notre parenté avec elles»[21]. Elle permet ainsi d’inclure le féminin dans la Trinité et de relier la Terre et le Ciel. Mary Judith Ress évoque une «Sagesse soutenante qui est partout et qui imprègne l’univers». Une manière de «renommer le Mystère de l’univers à la lumière des récentes découvertes scientifiques sur son origine»[22], en dialogue avec des penseurs quantiques et systémiques comme David Bohm, Gregory Bateson ou encore Carl Gustav Jung.
La Sagesse permet d’aller au-delà d’une conception trop masculine et humaine du Christ. Dans cette troisième piste, selon une tradition de la fin du ier siècle, Jésus serait une incarnation non seulement du Logos (masculin) mais de la Sophia (féminine), dont il manifeste la présence d’amour et l’action créatrice dans le monde. S’il est la Sagesse faite chair, cette dernière n’est pas seulement humaine – et encore moins de sexe masculin – mais cosmique. Johnson montre comment Dieu – à travers le Christ – s’unit à la vie, aux souffrances et à la mort de toutes les créatures en leur permettant de participer à sa puissance résurrectionnelle.
Dieu⸳e comme mère
Sur le versant de la refondation, des écoféministes chrétiennes proposent l’exploration de diverses métaphores féminines. Ainsi, Ruether parle de Dieu·e comme de la «la Matrice primordiale» «à partir de laquelle tout ce qui est évolue»[23]. Dans le prolongement, Gebara relie cette source créatrice à la «zôè-diversité de Dieu», symbolisée par la Trinité. Celle-ci manifeste la dynamique de la vie en tant que souffle et «processus de créativité interrelationnelle» à tous les niveaux de la toile du vivant. Mystère de communion dans la diversité, elle offre un modèle pour une «nouvelle conscience individuelle et collective» et la création d’une «citoyenneté cosmique et terrestre».
A la recherche d’un imaginaire alternatif à celui de la paternité divine, McFague file la métaphore de «Dieu comme mère». Elle la considère comme «une puissante image pour exprimer l’interconnexion de toute vie, qui est une composante centrale à la fois d’une sensibilité holistique et d’une compréhension de la foi chrétienne en tant que vision inclusive d’accomplissement»[24]. Dans cet accomplissement, dont le moteur est l’amour, Dieu⸳e donne la vie, nourrit ses créature et veille à leur épanouissement. Trois fonctions qui ne concernent pas uniquement l’espèce humaine, mais l’ensemble de la création. Si Denise Veillette voit dans cette métaphore une «révolution intellectuelle et de foi»[25], Louise Mélançon précise que «Dieu n’agit pas simplement comme une mère, mais qu’il est une mère»[26]. Féminiser Dieu·e en lui ajoutant des qualités présumément féminines comme la miséricorde, la douceur, la tendresse ou la compassion, ne suffit pas en effet pour remettre fondamentalement en cause le cadre conceptuel patriarcal.
En même temps, dans la conscience des limites des métaphores et du risque de reproduire des stéréotypes parentaux, Ruether propose de penser le divin au-delà du genre. Ultimement, Dieu·e est un mystère qui dépasse notre entendement et tout ce que l’on peut en dire. Iel est en même temps mère et père. Ou, mieux encore, ni mère ni père. La Réalité ultime à l’origine incréée de tout ce qui vit et respire, n’est pas sexuée.
Points critiques
On le voit. Le but de l’écoféminisme chrétien est de bousculer, déplacer les lignes et faire exploser les cadres pour tracer des horizons de libération et de justice au-delà des dominations croisées des femmes et de la nature. Parfois de l’ordre du cri du cœur ou de la colère, il n’est pas toujours nuancé dans sa critique de la culture patriarcale. Estimer par exemple que la tradition chrétienne a réduit la Trinité à «deux egos masculins désincarnés [le Père et le Fils], médiatisés par l’Esprit» ou «à un vieil homme [blanc], un jeune homme et un oiseau» est évidemment caricatural.
Le risque, quand on sort des sentiers battus, c’est de traverser des frontières. A l’évidence, l’écoféminisme chrétien comprend des affirmations qui peuvent être problématiques en ce qu’elles questionnent ou contestent le corpus dogmatique, certaines composantes essentielles de la foi et de la théologie. Ainsi, la relation entre «Gaïa, la Terre vivante et sacrée, et Dieu, la divinité monothéiste des traditions bibliques» est-elle vraiment «de fusion»[27], comme le suggère Ruether? La théorie Gaïa a certes beaucoup à apporter pour une compréhension renouvelée de la création, plus dynamique, évolutive et interreliée. Une grande différence, cependant, c’est que là où Gaïa s’autogénère, la création, ainsi que son nom l’indique, tire son origine et son existence d’un autre.
Le panenthéisme s’incarne de diverses manières chez les théologiennes. Toutes n’ont pas une position aussi équilibrée que Ruether. Certaines poussent très loin l’immanence divine. C’est notamment le cas de McFague qui va jusqu’à affirmer que Dieu change avec sa création dont il a besoin et dépend, au point d’être «vulnérable» et «en danger». A l’instar de la vision stoïcienne de l’âme du monde, la métaphore du monde comme «corps de Dieu» n’est-elle pas, au bout du compte, une forme de panthéisme? McFague n’hésite pas à rendre Dieu co-responsable du mal, lequel serait «une partie de son être» et se produirait en lui.
Autre interrogation: dans la vision de l’Etre divin comme matrice créatrice et souffle de vie, que devient la dimension personnelle de Dieu, qui s’est révélé comme «Je suis» au buisson ardent et qui, à partir des Ecritures, a été confessé comme une communion de trois personnes? La conception de Dieu comme une personne n’est-elle qu’un anthropomorphisme d’ordre patriarcal, ainsi que le laisse entendre Gebara?
Enfin, on a relevé la fécondité du Christ cosmique et féminin comme incarnation de la Sagesse. Mais quid de sa divinité comme «fils de Dieu» – peu évoquée chez les écoféministes, voire considérée comme une construction patriarcale et donc en partie rejetée? La revalorisation de la Sophia implique-t-elle de renoncer au Logos?
Invitation à l’engagement
Face à tous ces points critiques, certains n’hésitent pas à parler d’«hérésie». On n’entrera pas dans cette question, peu intéressante et au fond assez rance. Plutôt que d’accuser ou polémiquer, il convient de débattre. En se souvenant que la «vérité» du christianisme ne saurait être celle d’une seule interprétation dominante qui s’imposerait d’en haut. Ne repose-t-elle pas sur les récits – pluriels et parfois contradictoires – que des témoins ont laissés de l’événement Jésus? Les écrits écoféministes ont ceci de commun avec la parole du Christ qu’ils visent moins à répondre à nos questions qu’à interroger nos réponses, nos préjugés, nos habitudes et nos croyances pour nous remettre en mouvement.
Toutes ces inflexions par rapport à la théologie canonique doivent être reconnues, discutées, mises en relation et surtout considérées pour ce qu’elles sont dans le dessein écoféministe. Non pas un nouveau catéchisme, mais une parole vivante en quête d’un langage et de métaphores – jamais absolutisées par leurs autrices – capables de mettre la foi en résonnance et dialogue avec l’esprit du temps. McFague parle à cet égard de son travail comme d’une «esquisse». Gebara voit l’écoféminisme comme un «chemin spirituel» ouvert à la liberté de l’Esprit. Catharina Halkes évoque une démarche «qui transforme intérieurement nos convictions» et, par là-même, «nous place dans un horizon plus large et plus libre», nous offre «un espace pour vivre attentivement et pour écouter, ce qui est la base de la lutte pour la libération»[28].
Car telle est bien la finalité – éthique et politique – du «reclaim» écoféministe chrétien: soutenir la résistance aux «systèmes de violence économique, militaire et écologique qui menacent de défaire le tissu même de la vie sur la planète Terre»[29] et nourrir les engagements pour l’avènement de sociétés et d’Eglises post-patriarcales et respectueuses du vivant. Cela, en construisant des ponts et instaurant des dynamiques de fécondation mutuelle avec la science, les différentes traditions de sagesse et les divers courants de l’écoféminisme spirituel.
Il serait donc dommage que les points critiques deviennent des pierres d’achoppement conduisant à un rejet en bloc. Car l’écoféminisme chrétien a beaucoup à apporter pour faire évoluer la tradition chrétienne, renouveler la réflexion théologique et éthique, développer notre sensibilité au vivant, stimuler notre intelligence et notre imaginaire, inspirer les quêtes de sens, développer un «amour engagé» (Ruether) et partagé au service de la Terre.
Notes
[1] Une première formulation de l’écoféminisme est attribué à Françoise d’Eaubonne dans son livre Le féminisme ou la mort, Horay, 1974 (réédition Le Passager clandestin, 2020).
[2] Jeanne Burgart Goutal, Être écoféministe. Théories et pratiques, Paris, L’Echappée, 2020, p. 87.
[3] Karen J. Warren, «Le pouvoir et la promesse de l’écoféminisme», Multitudes, n° 36, 2009/1, p. 172.
[4] Nous choisissons le terme «Dieu·e» pour exprimer l’inclusivité recherchée par les théologiennes écoféministes. Pour ces dernières, Dieu·e est fondamentalement au-delà du genre, mais peut-être exprimé·e par des métaphores aussi bien féminines que masculines. En même temps, par respect pour le texte original, nous ne l’utilisons pas dans les traductions de citations, sauf lorsque l’inclusive est explicite.
[5] Heather Eaton, Introducing Ecofeminist Theologies, London & New York, T&T Clark International, p. 36.
[6] Lettre au Pape François, UCLouvain, 28 septembre 2024, p. 3.
[7] UCLouvain, Réaction au discours du Pape: des convergences de fond, mais une divergence majeure, Communiqué de presse, 30 septembre 2024.
[8] Voir l’anthologie réalisée par Charlotte Luyckx et Michel Maxime Egger, Gaïa et Dieu·e. Un écoféminisme chrétien est possible, Editions de l’Atelier, 2025.
[9] Pour reprendre le titre de l’anthologie sur l’écoféminisme réalisée par Emilie Hache, Reclaim, Paris, Cambourakis, 2016.
[10] Rosemary Radford Ruether, Gaia & God. Ecofeminist Theology of Earth Healing, San Francisco, HarperSanFrancisco, 1994, p. 249.
[11] Rosemary Radford Ruether, «The Biblical Vision of the Ecological Crisis», The Christian Century, 22 November 1978, p. 1131.
[12] Heather Eaton, Introducing Ecofeminist Theologies, op. cit., p. 64.
[13] Ivone Gebara, Longing for Running Waters. Ecofeminism and Liberation, Minneapolis, Fortress Press, 1999, p. 54.
[14] Dorothee Sölle, «Feministische Suche nach den Namen Gottes», Gesammelte Werke, Band 9: Gott denken, Freiburg im Breisgau, Herder, 2023, p. 266.
[15] Rosemary Radford Ruether, «Le Dieu des possibilités: l’immanence et la transcendance repensées», Théologiques, vol. 8, no 2, automne 2000, p. 37.
[16] Heather Eaton, Introducing Ecofeminist Theologies, op. cit., p. 77.
[17] Ivone Gebara, Le mal au féminin. Réflexions théologiques à partir du féminisme, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 223.
[18] Rosemary Radford Ruether, Goddesses and the Divine Feminine, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1985, p. 308.
[19] Rosemary Radford Ruether, «Ecofeminism: The Challenge to Theology», DEP Deportate, esuli, profughe, n° 20/2012, p. 32.
[20] Elizabeth A. Johnson, Women, Earth, and Creator Spirit, New York, Paulist Press, 1993, p. 42-43.
[21] Celia Deane-Drummond, Ecothéologies, Paris, Editions jésuites, 2024, p. 298.
[22] Mary Judith Ress, «Sabiduria que sostiene. Renombrando el misterio ùltimo desde une perspectiva ecofeminista», Con-spirando, 38/01, Santiago de Chile, 2001, p. 43 et 37.
[23] Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-Talk. Toward a Feminist Theology, Boston, Beacon Press, 1983, p. 85 et 71.
[24] Sallie McFague, Models of God. Theology for an Ecological, Nuclear Age, Minneapolis, Fortress Press, p. 100.
[25] Denise Veillette, «Exister, penser, croire autrement. Thématique religieuse féministe de la revue Concilium», Recherches féministes, 3 (2), 1990, p. 45.
[26] Louise Mélançon, «Je crois en Dieu-e. La théologie féministe et la question du pouvoir», Théologiques, vol. 8, no 2, automne 2000, p. 90.
[27] Rosemary Radford Ruether, Gaia & God, op. cit., p. 240.
[28] Catharina Halkes, «Feminism and Spirituality», Spirituality Today, vol 40, n 3, Automn 1988.
[29] Rosemary Radford Ruether, Goddesses and the Divine Feminine, op. cit., p. 308.