Idées-forces
Résonances«Si le seul outil que vous avez est un marteau, vous tendez à voir tout problème comme un clou», affirmait le psychologue humaniste Abraham Maslow. Comme en écho, Albert Einstein renchérissait : «On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré.» D’où l’importance de notions et concepts pour changer de paradigme, articuler transformation de soi et transformation du monde, nous aider à penser autrement le monde, éclairer les mutations en cours, donner du sens à nos actions, définir des pistes pour sortir du solutionnisme, briser les cadres dans lesquels nous sommes enfermés et tournons en rond, inventer de nouvelles manières d’être, de vivre et d’habiter le monde avec d’autres.
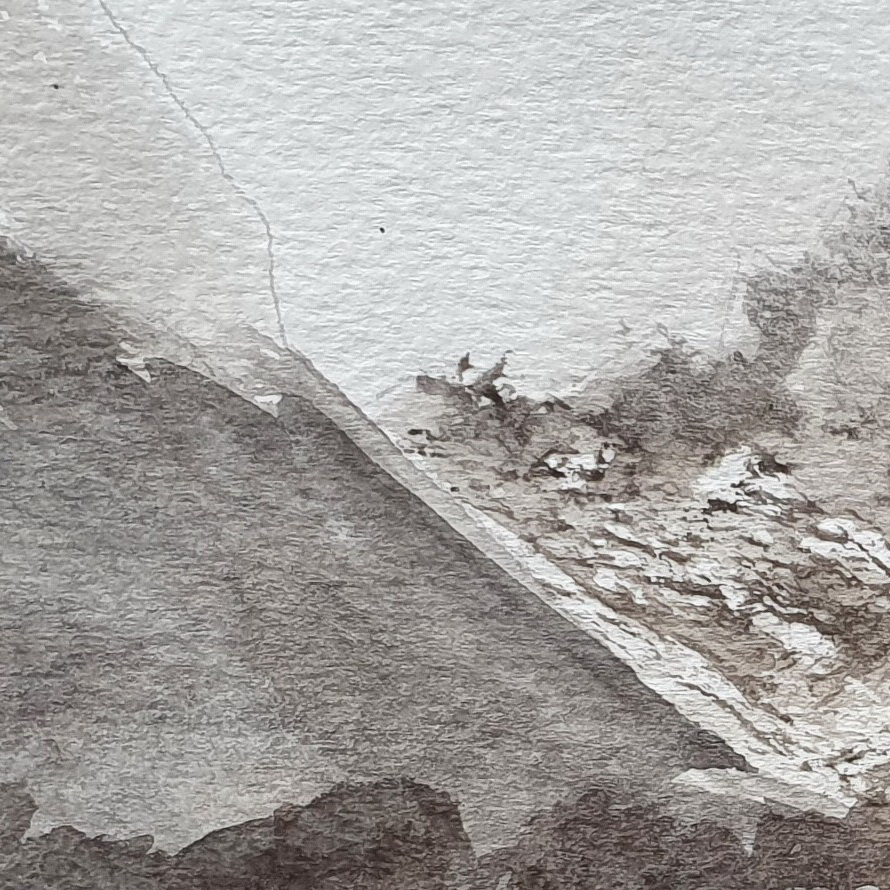
Dé-coïncidence
Peut-on encore projeter de grands plans sur le futur et s’y fier?
Cela se heurte désormais au moins à deux difficultés. D’une part, le monde «mondialisé» est devenu trop complexe, le jeu de trop d’interdépendances, pour qu’une modélisation – autre que technique – y soit assurée. D’autre part, on n’y voit plus d’attente qui soit constructive d’avenir. Si l’on ne peut plus rêver de «lendemains qui chantent», c’est que ces lendemains ne nous parlent plus. Le thème des jours meilleurs ne prend plus.
Or, en même temps, dire «non» face à la situation qui menace, la dénoncer, ne s’entend plus, ne suffit plus. À défaut de pouvoir projeter dans l’au-delà, il faudrait donc intervenir en amont. Il faudrait pouvoir défaire les représentations installées dont on constate qu’elles bloquent l’action politique et la société. Il faudrait décoincer ce qui entrave, plutôt que d’annoncer sans cesse la Rupture et l’«innovation». Il faudrait se décaler de ces lieux communs imposés qui paralysent. Il faudrait, autrement dit, en «dé-coïncider».
On croirait pourtant que, quand tout «coïncide», entre en adéquation, s’avère adapté, c’est parfait: ça «colle». Or cette coïncidence est la mort: ce qui coïncide, se confortant dans sa coïncidence, s’endort dans sa positivité et ne produit plus que du conformisme. Les possibles en sont bloqués. Une idée, en devenant coïncidente, devient idéologique; elle sécrète la bonne conscience et n’est plus pensée. Même les meilleures causes n’y échappent pas. […]
Or, dé-coïncider, en défaisant la coïncidence installée, ne promet pas d’«avenir qui fait rêver». Mais s’ouvrent de nouveaux possibles. Cela se vérifie dans les pratiques les plus diverses. Un artiste n’est artiste qu’autant qu’il dé-coïncide de l’art déjà fait et reconnu comme art. Un penseur ne pense qu’autant qu’il dé-coïncide du déjà pensé. Vivre est dé-coïncider du déjà vécu. Il faut aussi dé-coïncider de soi pour rencontrer l’Autre.
Or ne peut-on passer par là de l’éthique au politique? […] Or justement la dé-coïncidence permet de ne plus avoir à penser en termes de « théorie » et de « pratique », ou de modèle et de réel. Par conséquent aussi de ne plus avoir à penser la politique en termes de Rupture proclamée, d’Action spectaculaire ou de Grand soir attendu.
Dé-coïncider nous met en effet directement à l’œuvre, nous situe d’emblée dans l’effectif. Il s’agit d’initiatives sans commandement, locales, plurielles «de terrain», d’abord diverses et discrètes, mais qui font leur chemin. Chacun, là où il est, peut en engager. Dès lors que j’ouvre un écart vis-à-vis de thèmes et de comportements si bien scellés, commence de les fissurer, je me mets du même coup à dé-coïncider. Donc à rouvrir des possibles. […]
Certes, ce ne sont là que « fissures» dans la carapace qu’organisent la dictature du marché mondial, les lois de la mise en réseau et l’anonyme – inhumaine – technicité. Mais ces fissures peuvent se relier et se faire écho: elles peuvent s’associer et se soutenir, rouvrir un commun partagé.
Extraits du «Manifeste» en lien avec l’ouvrage Rouvrir des possibles, Éditions de l’Observatoire, 2023. Pour lire le texte complet.
Devenir
Devenir, ce n’est jamais imiter, ni faire comme, ni se conformer à un modèle, fût-il de justice ou de vérité. Il n’y a pas un terme dont on part, ni auquel on arrive ou on doit arriver. Pas non plus deux termes qui s’échangent. La question «qu’est-ce que tu deviens?» est particulièrement stupide. Car à mesure que quelqu’un devient, ce qu’il devient change autant que lui-même. […]
Ce qui compte dans un chemin, ce qui compte dans une ligne, c’est toujours le milieu, pas le début ni la fin. On est toujours au milieu d’un chemin, au milieu de quelque chose. L’ennuyeux dans les questions et les réponses, dans les interviews, dans les entretiens, c’est qu’il s’agit le plus souvent de faire le point: le passé et le présent, le présent et l’avenir. C’est même pourquoi il est toujours possible de dire à un auteur que sa première œuvre contenait déjà tout, ou au contraire qu’il ne cesse de se renouveler, de se transformer. De toutes manières, c’est le thème de l’embryon qui évolue, soit à partir d’une préformation dans le germe, soit en fonction de structurations successives. Mais l’embryon, l’évolution, ce ne sont pas de bonnes choses. Le devenir ne passe pas par là. Dans le devenir, il n’y a pas de passé ni d’avenir, ni même de présent, il n’y a pas d’histoire. Dans le devenir, il s’agit plutôt d’involuer: ce n’est ni régresser, ni progresser. Devenir, c’est devenir de plus en plus sobre, de plus en plus simple, devenir de plus en plus désert, et par là même peuplé. C’est cela qui est difficile à expliquer: à quel point involuer, c’est évidemment le contraire d’évoluer, mais c’est aussi le contraire de régresser, revenir à une enfance, ou à un monde primitif. Involuer, c’est avoir une marche de plus en plus simple, économe, sobre. […]
L’expérimentation est involutive, le contraire de l’over-dose. C’est vrai aussi de l’écriture: arriver à cette sobriété, cette simplicité qui n’est ni la fin ni le début de quelque chose. Involuer, c’est être «entre», au milieu, adjacent. […]
Les embryons, les arbres, se développent, suivant leur préformation génétique ou leurs réorganisations structurales. Mais pas la mauvaise herbe: elle déborde à force d’être sobre. Elle pousse entre. Elle est le chemin lui-même. […]
Henry Miller: «L’herbe n’existe qu’entre les grands espaces non cultivés. Elle comble les vides. Elle pousse entre – parmi les autres choses. La fleur est belle, le chou est utile, le pavot rend fou. Mais l’herbe est débordement, c’est une leçon de morale.» La promenade comme acte, comme politique, comme expérimentation, comme vie: « Je m’étends comme de la brume ENTRE les personnes que je connais le mieux», dit Virginia Woolf dans sa promenade parmi les taxis.
Source: Dialogues, Editions Flammarion, 1977, p. 8, 37-39.
Spiritualité
Pour notre part, la spiritualité désigne la relation à un autre plan du réel, de la vie et de la conscience: le «plus grand que soi». Une dimension à laquelle renvoie l’étymologie du mot, qui vient du latin spiritus et veut dire l’esprit. Dans notre perspective, ce n’est pas (seulement) la vie de l’esprit (avec minuscule), mais la vie de ou dans l’Esprit (avec majuscule) comme expression précisément du «plus grand que soi». Pour certaines personnes, ce dernier sera immanent et de même nature que le vivant; on parlera par exemple de l’âme du monde. Pour d’autres, il sera transcendant et d’essence différente que le vivant; c’est par exemple le Dieu créateur, «au-delà de tout» et «tout autre» des révélations monothéistes. Pour d’autres encore, il sera à la fois immanent et transcendant; c’est par exemple la position du «panenthéisme», qui signifie «tout en Dieu et Dieu en tout». Une vision paradoxale qui unit sans les confondre et distingue sans les séparer le divin et le vivant.
Dans le respect de la diversité des expériences et croyances, un point nous paraît essentiel pour une spiritualité de la transition, qui ne peut être que non dogmatique, ouverte et sans exclusive: le «plus grand que soi» est un mystère ineffable «qui nous dépasse et fait partie inhérente de la vie sur Terre». Or, un mystère ne s’explique pas et ne se résout pas comme une énigme, il se vit et se célèbre. Ainsi qu’en témoignent les mystiques, on n’y accède qu’en participant à sa vie même. Il échappe à notre compréhension, excède tous les noms et images dont on l’affuble: le Réel ultime, l’Esprit, le Souffle, l’Un, l’Infini, la grande Déesse, Dieu, la Présence, etc. Certaines traditions le personnifient, d’autres en parlent comme d’une énergie impersonnelle ou cosmique. Quelle que soit la forme et la dénomination, pour paraphraser le théologien Jean-Yves Leloup , il renvoie à l’Être, la Conscience, la Vie, la Relation et l’Amour qui est à la source de tout être, de toute conscience, de toute vie, de toute relation et de tout amour.
On peut donc entendre la spiritualité comme une vie reliée au «plus grand que soi», lequel est la source secrète, humble, puissante et féconde du vivant. Le psychiatre Christophe André parle joliment de l’ouverture de notre être par nature fini, éphémère et relatif aux «trois vertiges que sont l’infini, l’éternité, et l’absolu ». Autrement dit, indissociable d’une descente dans le «fond sans fond » de notre être et du vivant, la spiritualité renvoie à l’expérience d’un Souffle ou d’une Présence qui nous porte à la fois au cœur et au-delà de nous-mêmes.
Source: Reliance. Manuel de transition intérieure, Actes Sud, 2023, p. 103-104.
Transversalité
Le chercheur en Approche Transversale n’hésite pas à l’écouter en lui et chez les autres et à se laisser porter par son flux et son reflux océaniques d’une manière créative et imprévue. Il est l’homme de la métaphore avant d’être l’homme du concept. Il relie ce qui est divisé et distingue ce qui est confondu. Il efface la frontière introuvable entre cerveau gauche et cerveau droit dès qu’il s’agit de comprendre la vie en acte. Il sait prendre place dans l’étoile filante de l’événement et traverser comme un éclair les royaumes endormis de l’institué. Il est le médiateur de la nuit et du jour. Son soleil est un nuage. Son sable ne construit pas de château. Il voyage non pas sur mais dans les images. Il laisse les cisailles du concept à ceux qui ne savent plus sourire du presque rien. Il sait que le blanc concilie toutes les couleurs. Il a découvert dans le noir la source de toute blancheur. Il caresse dans la neige l’échine de l’incendie. Il surprend dans la flamme une eau plus pure que l’émeraude. Il donne ce qui demeure inchangé et accueille ce qui manque à chacun. Il est l’homme requalifié qui unifie dans tout instant amour, mort et création. II est sans projet puisqu’il est la rivière sans rives. Il est sans programme puisqu’il a découvert ce qui n’est pas dans le bleu du ciel. Adossé contre un arbre mort, il est la femme. Proche d’un oiseau qui s’envole, il est l’homme. Dans toutes les fleurs il revoit son enfance. Dans tout enfant il distingue un conteur vieillissant. Comme un aveugle il suit le silence, son chien errant. Son poème n’est pas message mais massage de l’âme. Ses images ne sont pas des tanks mais des lasers ou des bulles d’eau bleue.
On ne revient jamais bruyant d’un poème.
Toute parole poétique porte le losange du mot naissance.
Avec elle nous savons que la source surgit encore à l’embouchure du fleuve.
Source: L'Approche Transversale - une conception de la parole en fonction de la pensée chinoise, texte partagé par l'auteur.
Universel
Contre l’idée reçue que les auteurs qu’on désigne comme «postcoloniaux» ou «décoloniaux» ne parlent que de leurs particularismes pour les opposer à l’universalisme, il est bon, en effet, de rappeler, par exemple, que tout poètes et théoriciens de la «négritude» qu’ils fussent, Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire ont été aussi, ont été avant tout, des penseurs de la totalité du monde et de notre temps, ainsi que de l’exigence de mener combat, non pas seulement contre le colonialisme, mais aussi pour un «humanisme du vingtième siècle» (Senghor), pour un «humanisme universel» (Césaire). Il faut du reste préciser que c’est au nom de cet humanisme universel qu’ils ont soutenu que le combat devait être mené.[…]
Premièrement, nous vivons un moment à la fois historique et philosophique, que l’on dira postcolonial ou décolonial, et qui est celui de la fin d’un certain universalisme impérial. Deuxièmement, cette fin signifie que nous incombe désormais la tâche de réinventer l’universel.[…]
Décoloniser pour fonder l’humanisme universel. Voilà un propos qu’il faut penser aujourd’hui dans une période où nous sommes tellement divisés par nos identitarismes en de véritables tribus que nous ne mettons pas les mêmes dénotations sous les mêmes mots, en particulier ceux, nouveaux, dont l’emploi indique nos appartenances plus qu’ils ne sont échangés comme éléments d’une argumentation, dans le cadre d’un dialogue: quand l’agora n’est plus que l’espace de performances identitaristes, le sens lui-même se brise en fragments.On le constate avec la querelle du wokisme qui prend souvent les allures d’une guerre picrocholine, dans l’oubli que l’exigence de rester vigilant, woke donc en anglais, signifiait pour Martin Luther King, lorsqu’il employait le mot, l’impératif d’être attentif à toutes les victimisations de l’humain pour les combattre, au nom de l’humain. Cet appel à la vigilance, dans la théorie et dans la pratique, est le même que celui qu’avait lancé Frantz Fanon: «Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l’oreille, on parle de vous.»
Le sens étant celui-là, il va à contresens de la manière dont on construit aujourd’hui des campagnes identitaires sous la forme de croisade contre le «wokisme». C’est une réalité qu’aujourd’hui des partis de la droite extrême construisent leur audience auprès d’un électorat auquel ils serinent que la politique est désormais une guerre culturelle, voire tribale, en agitant entre autres l’épouvantail d’un wokisme censé introduire dans le champ académique des programmes qui, eux, n’ont rien d’académique et tout du militantisme.[…]
Autrement dit, il nous faut penser le pluriel et le décentrement du monde contre une configuration qui en ferait une juxtaposition de centrismes, séparatistes par définition: un monde de tribus. Contre la fragmentation irréductible il nous faut rappeler que ce qui s’enseigne doit valoir universellement. […]
Concernant les termes «postcolonial» et «décolonial», on considère en général que le premier renvoie à la situation d’un monde où le colonialisme n’a plus aucune justification et où les pays anciennement colonisés ont, pour l’essentiel, accédé à la souveraineté, tandis que le second indique qu’il est toujours nécessaire et urgent d’analyser et de combattre la «colonialité» en laquelle se perpétue la domination.[…]
Mais, d’une manière générale, la pensée dé-coloniale qui s’est développée surtout en Amérique latine appelle à la décolonisation des savoirs et à la réhabilitation de connaissances «indigènes» marginalisées, surtout lorsqu’elles traduisent des cosmologies qui inscrivent l’humain dans le vivant et reconnaissent des droits à la nature… Enrique Dussel, par exemple, a produit une œuvre importante pour une décolonisation de la théologie qui sera alors une théologie de la libération et pour une décolonisation de la philosophie contre l’invention, au début du XIXe siècle, de cette discipline comme une affaire purement et exclusivement européenne.
Dans un monde pluriel, postcolonial, pourquoi vouloir l’universel ? Cette question me fut posée par Édouard Glissant un jour de mai 2010 où il m’avait invité à présenter, à l’Institut du Tout-Monde qu’il avait créé et que François Noudelmann dirigeait, une conférence à laquelle j’avais donné pour titre: «Le postcolonial et l’universel». L’auteur de la Poétique de la relation est penseur d’une mondialité dans laquelle les cultures sont des opacités qui résistent donc à l’assimilation colonisatrice, maintenant ainsi le pluriel du monde, tout en étant ouvertes à et dans la relation, c’est-à-dire l’échange, avec le « Tout-Monde ». Relation plutôt qu’universel, telle était le propos qu’exprimait amicalement la question d’Édouard Glissant.
Je comprends l’opposition entre la «relation» et «l’unicité excluante». Ou que l’on préfère parler de «pluriversel» pour insister sur la pluralité et l’équivalence des cultures humaines. Mais je soutiens qu’il ne faut pas abandonner le concept d’universel, car ce serait s’empêcher de penser le premier universel qui est l’humanité. Or, ainsi que l’écrit Francis Wolff, «jamais nous n’avons été aussi conscients de former une seule humanité», à la fois parce que les moyens de communication qui ont fait de notre planète un village nous en donnent ce qu’il appelle «une conscience horizontale globale», et parce que deux crises planétaires, entre autres défis, celle, sanitaire, de la covid et celle, environnementale, du changement climatique, ont transformé en un véritable sentiment l’idée que nous sommes une seule et même espèce, vulnérable.
Pour conclure sur ce point de la réinvention de l’universel, on se gardera de penser la question comme une opposition décoloniale à l’universalisme européen. Cela signifie éviter deux idées fausses.
La première consiste, il faut y revenir, à considérer que «décolonial» signifie nécessairement relativisme et particularisme. Sur ce point, la déclaration de Césaire sur la visée d’un humanisme universel est capitale et elle fait écho à la manière dont l’organisateur principal de la rencontre de Rome de 1959 en a présenté le propos. Cet organisateur est Alioune Diop (1910-1980), le fondateur en 1947 de la revue Présence Africaine puis, deux ans plus tard, de la maison d’édition qui porte le même nom. Voici ce qu’il a déclaré à la conférence: «Désoccidentaliser pour universaliser, tel est notre souhait. Pour universaliser, il importe que tous soient présents dans l’œuvre créatrice de l’humanité.»La seconde idée fausse est que l’expression «universalisme européen» a une dénotation claire et précise. Se donner, sans autre forme de procès, la notion d’une Europe qui serait uniment porteuse d’un même universalisme relève d’un essentialisme qui masque le fait, par exemple, que le récit français de soi comme porteur de l’universel n’est pas d’abord, n’est pas nécessairement celui de l’Europe en général.
Source: Universaliser. Pour un dialogue des cultures, Albin Michel, 2024, extrait de l'introduction.