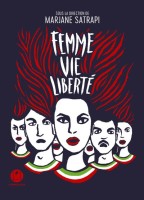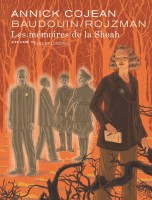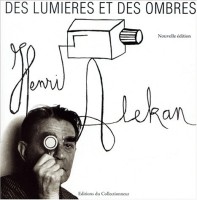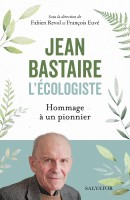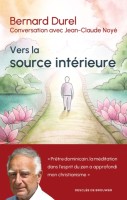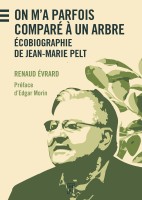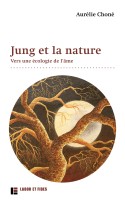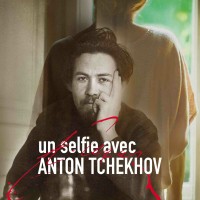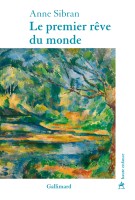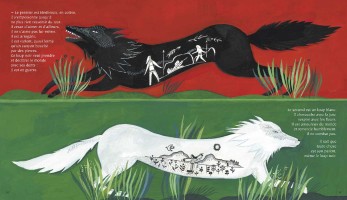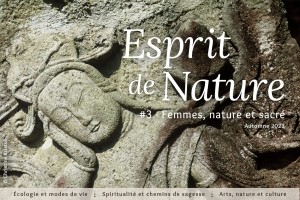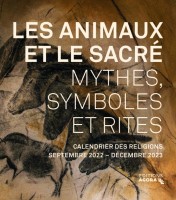Jean-Claude Guillebaud: Comment je suis redevenu chrétien
Un petit livre clair et roboratif où Jean-Claude Guillebaud explique sa conviction que «le message évangélique garde une valeur fondatrice pour les hommes de ce temps, y compris pour ceux qui ne croient pas en Dieu». A trois conditions cependant: le refus de l’injonction au profit du témoignage vécu et du dialogue, la réinterprétation créative incessante des textes, le renouvellement profond du langage. L’auteur raconte son propre voyage intellectuel et existentiel à travers trois cercles. D’abord, la redécouverte des sources judéo-chrétiennes de la modernité comme les droits humains et une conception du temps source d’espérance. Ensuite, la «subversion évangélique» qui proclame l’innocence des victimes, révèle l’aveuglement mimétique des persécuteurs, appelle à lutter de manière non violente contre la tyrannie, les injustices et les logiques de domination. Enfin, «le saut personnel et subjectif de la foi, qui permet de franchir les abîmes du doute».
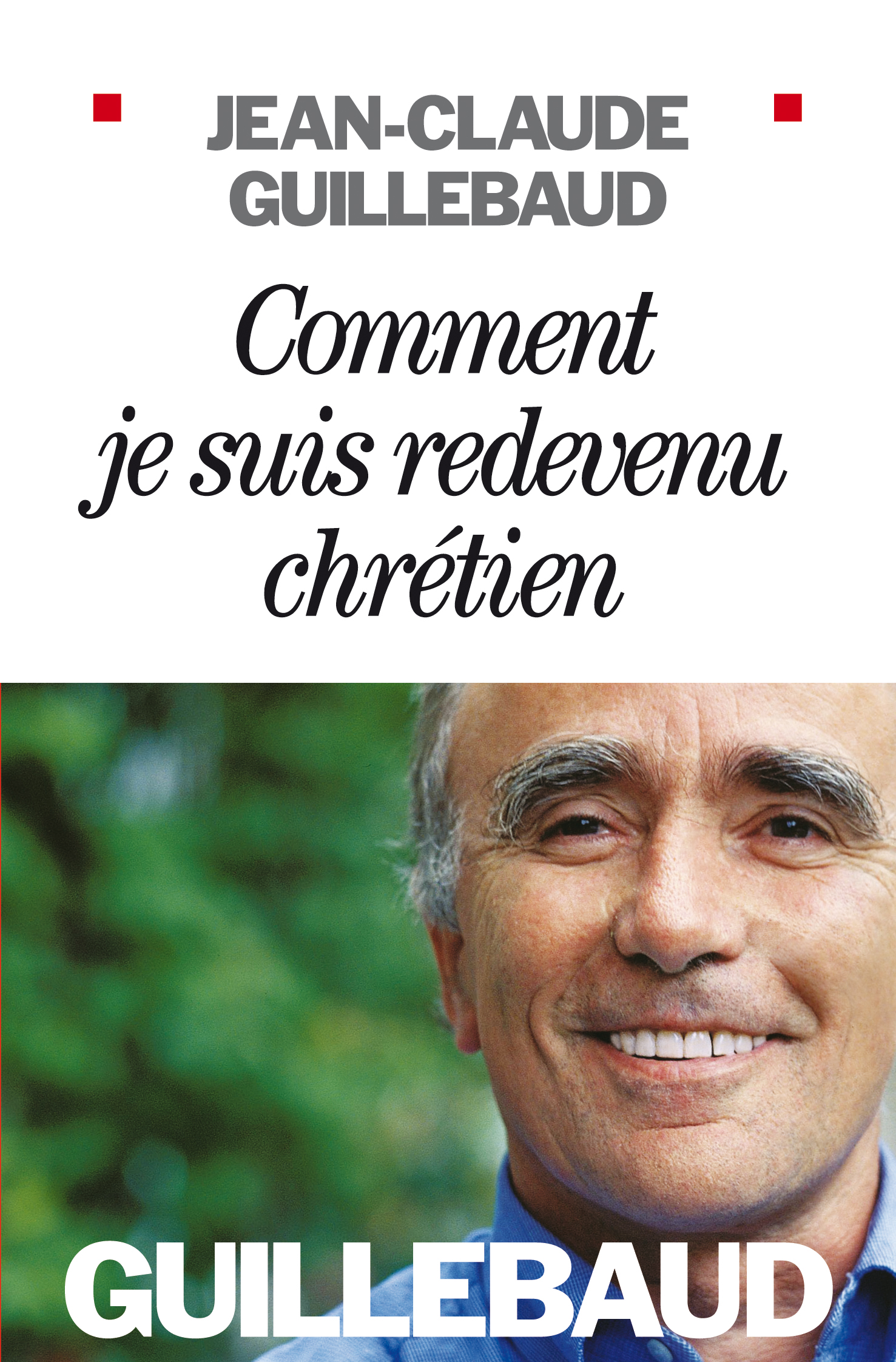
Longtemps, le journaliste, éditeur et essayiste Jean-Claude Guillebaud s’est dérobé à la question de savoir s’il était chrétien. Il l’aborde de front dans ce petit livre clair et roboratif, où il tente d’être au plus près de son vécu. On n’y trouve nulle trace d’exaltation ou de sentimentalité religieuse. L’auteur se dit un fils des Lumières. Son terrain n’est pas la mystique ni même la quête spirituelle, mais l’anthropologie. Son approche se veut délibérément rationnelle. Avec d’autant plus de force que gronde en lui une colère devant le dédain et la condescendance que les médias, la gauche politique, les milieux scientifiques et philosophiques réservent souvent aux chrétiens.
Un message fondateur et actuel
L’objectif de l’ouvrage est double. Il s’agit, d’une part, de montrer la pertinence essentielle de la parole biblique en ces temps d’apocalypse et de bifurcation civilisationnelle. Guillebaud est convaincu que «le message évangélique garde une valeur fondatrice pour les hommes de ce temps, y compris pour ceux qui ne croient pas en Dieu». Les chrétiens ont encore quelque chose à dire au monde et sur le monde actuel. Ils sont appelés, comme le disait déjà Albert Camus, à «parler à haute et claire voix», à «sortir de l’abstraction et à se mettre en face de la figure ensanglantée qu’a prise l’histoire aujourd’hui».
Mais ils ne pourront se faire entendre, participer d’une manière féconde aux débats de société qu’à trois conditions. Primo, que leur parole ne procède pas de l’injonction cléricale, morale ou dogmatique, mais du témoignage, du dialogue, de la proposition de sens alternative et authentiquement vécue. Une parole «ouverte à la critique, argumentée avec rigueur et énoncée sans arrogance». Secundo, qu’ils osent une réinterprétation créative incessante des textes, pour retrouver la signification cachée des mots et en faire jaillir les inépuisables trésors de sens. Tertio, qu’ils s’attellent à un renouvellement profond de leur langage pour rendre leur message intelligible : «La réinvention d’une syntaxe permettant de dire le christianisme au monde contemporain et de redonner vie aux mots de la prière exigera plus qu’un toilettage».
Aux sources de la modernité
D’autre part, l’auteur raconte son voyage intellectuel et existentiel vers la foi chrétienne. Il évoque trois cercles concentriques. Le premier, périphérique, est la redécouverte des sources judéo-chrétiennes de la modernité. Droits humains, démocratie, liberté de conscience, souveraineté de la personne, sens de l’universalité… La plupart des convictions et valeurs qui fondent nos sociétés ne proviennent pas seulement du siècle des Lumières (XVIIIe s.), mais puisent leurs racines dans l’héritage biblique et, plus spécifiquement, évangélique.
Il en va de même de la vision linéaire du temps et du principe d’espérance qui en découle. Si le temps est droit, «l’histoire humaine est enracinée dans une mémoire et orientée vers un projet». Loin d’être prisonniers d’un destin inéluctable et de la loi de l’éternel retour, les êtres humains «sont coresponsables du futur; ils ont en charge l’achèvement et l’amélioration du monde». L’Histoire, en ce sens, ne saurait être abandonnée aux seules forces du marché, du pouvoir et du mal qui consacrent l’écrasement des faibles par les forts, le triomphe des riches sur les pauvres. «La politique, c’est le goût de l’avenir», disait Max Weber. Le problème, affirme l’auteur, c’est que ce goût est en panne. On ne pourra le retrouver, refonder notre espérance et revivifier les valeurs fondatrices démocratiques qu’en rétablissant «le fil qui les relie, de siècle en siècle, à leur matrice originelle», judéo-chrétienne.
Subversion évangélique
Le deuxième cercle, médian, est la «subversion évangélique». Pour l’auteur, proche du philosophe René Girard, l’Évangile a «fendu en deux l’histoire du monde». Cela, en inversant le sens traditionnel et religieux du sacrifice, fondé sur le point de vue aveugle des persécuteurs, unanimement convaincus que les victimes sont effectivement coupables et qu’elles doivent être sacrifiées sur l’autel de la paix sociale. La résurrection de Jésus a causé un scandale et marqué une rupture fondatrice en proclamant l’innocence des victimes, de toutes les victimes accusées par toutes les cultures humaines. Elle a révélé l’imposture et l’aveuglement mimétique des persécuteurs. D’où la puissance prophétique de l’Évangile qui appelle à lutter de manière non violente contre la tyrannie, à refuser les injustices, à chambouler les logiques de domination et à résister au «caractère clairement sacrificiel du néolibéralisme».
Le christianisme est, par essence, non normatif, protestataire et dissident. Tout le contraire de ce que l’Église en a souvent fait, avec ses pesanteurs cléricales, son enfermement dogmatique, son moralisme et ses catéchismes sclérosants, ses compromissions avec les puissants de ce monde. Ces «trahisons», estime Guillebaud, ne sont pas cependant une raison suffisante pour abolir ou déserter l’institution ecclésiale. Certes, la parole vive, celle qui nourrit le feu évangélique, «circule et s’énonce le plus souvent dans les marges de l’Église, quand ce n’est pas en réaction contre elle». Mais en même temps, sans l’Église, le message de la foi n’aurait pas été transmis. «Dissidence et institution sont comme l’avers et le revers d’une même vérité en mouvement». Autant les humains ont besoin de l’Église pour l’apprentissage du croire, autant ils doivent «apprendre à résister à son autorité»: «Un enfant ne conquiert son statut d’adulte qu’en s’émancipant de la famille qui lui a permis de construire son humanité».
Le troisième cercle, central, est celui de la foi proprement dite. Cette foi que l’auteur n’est pas encore sûr intimement d’avoir, même si elle relève pour lui moins d’un effet de la grâce divine (il n’en parle jamais) que d’un libre choix et d’un engagement délibéré. Guillebaud affirme en être là: il se trouve «sur le plongeoir», prêt à effectuer «le saut personnel et subjectif qui permet de franchir les abîmes du doute».
Recension par Michel Maxime Egger, La Chair et le Souffle, Vol. 3, No 1, 2008, p. 91-93.
Jean-Claude Guillebaud, Comment je suis redevenu chrétien Paris, Albin Michel, 2007, 183 p. ; réédité en poche, Seuil, Points Essais, 2015, 193 p.